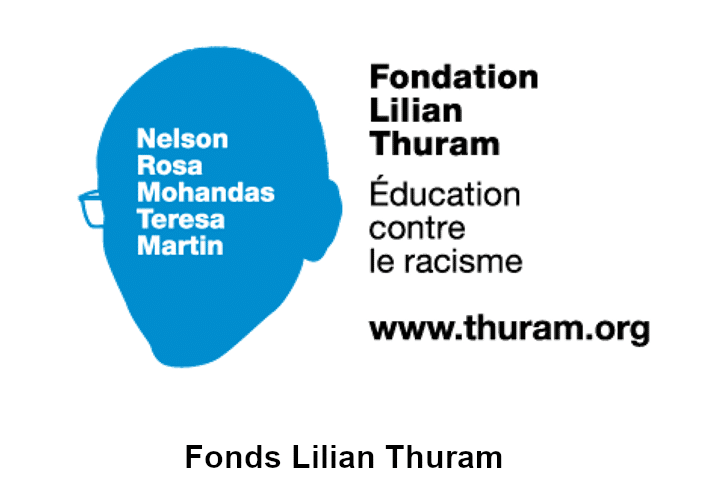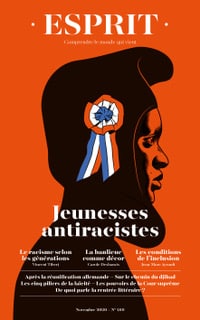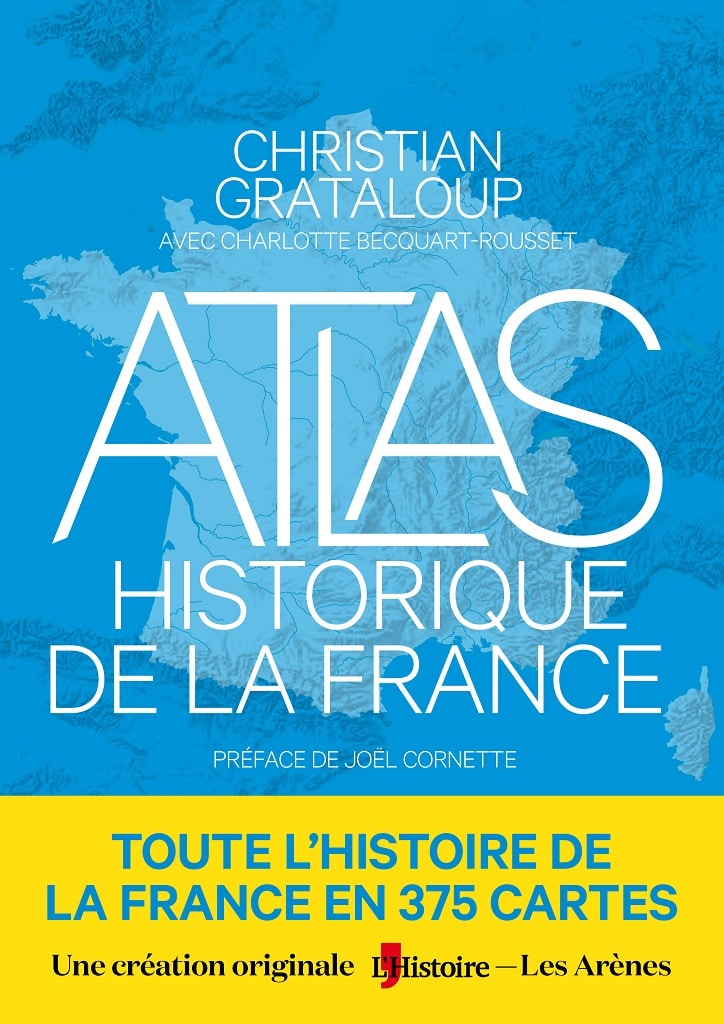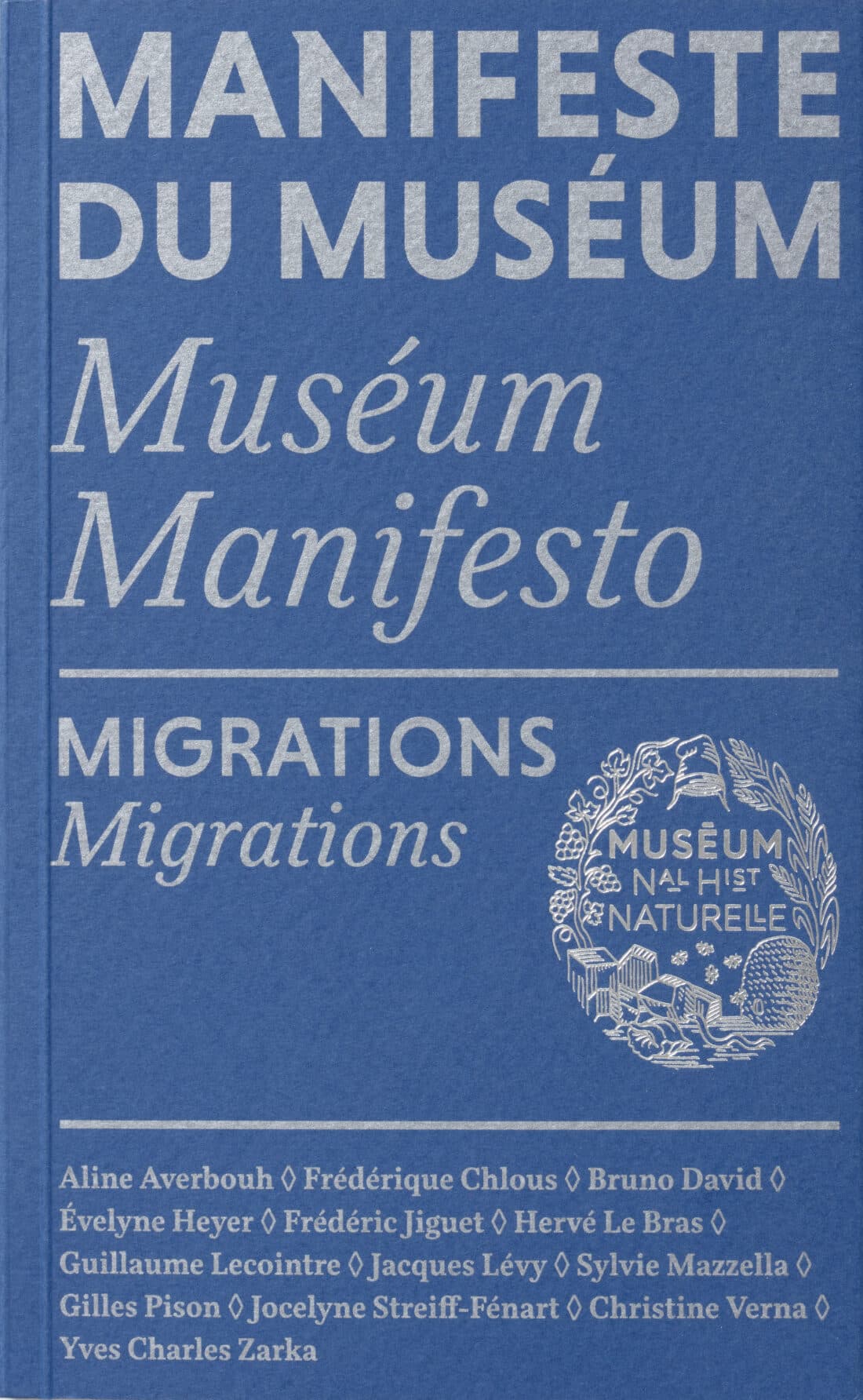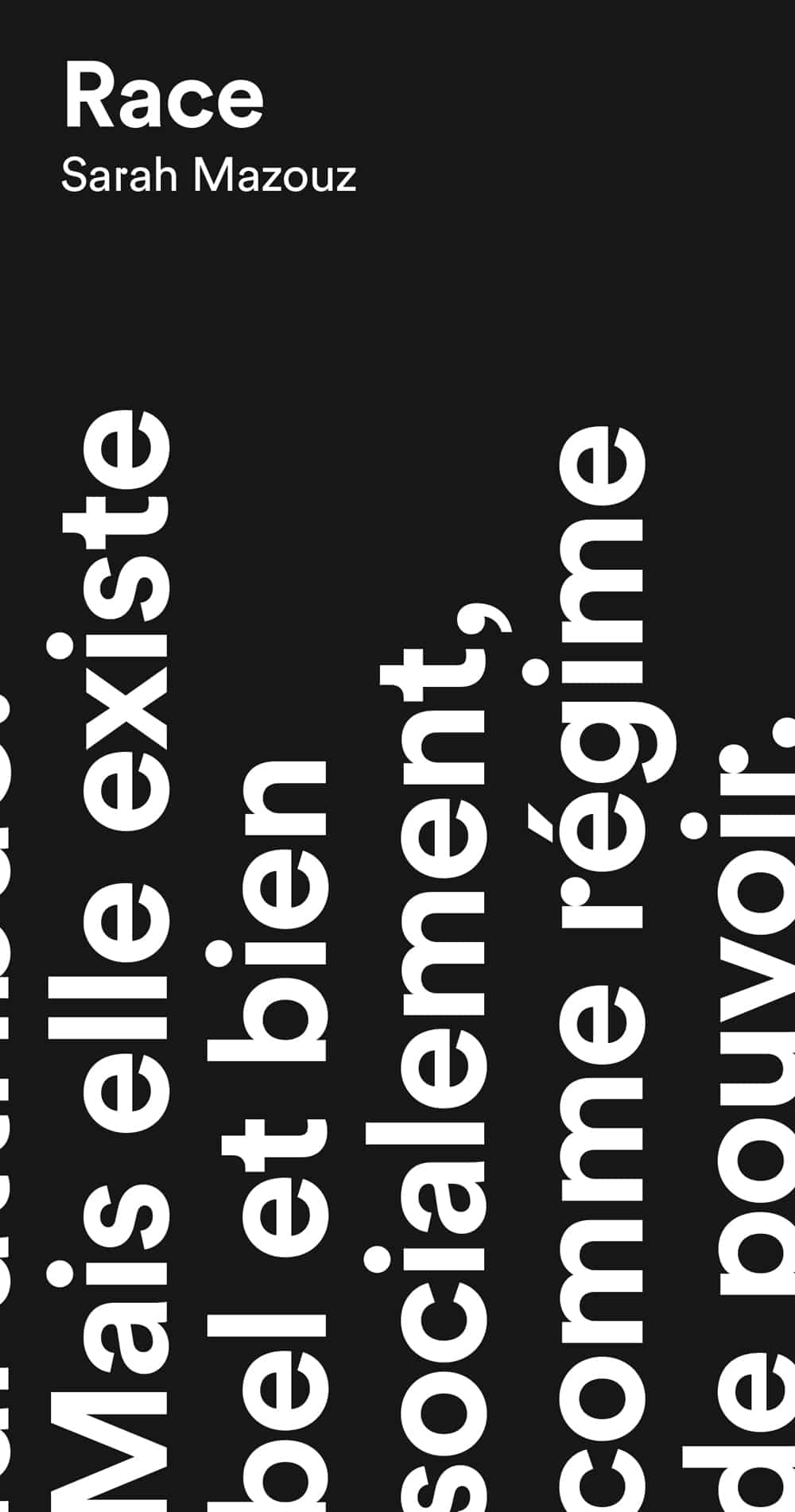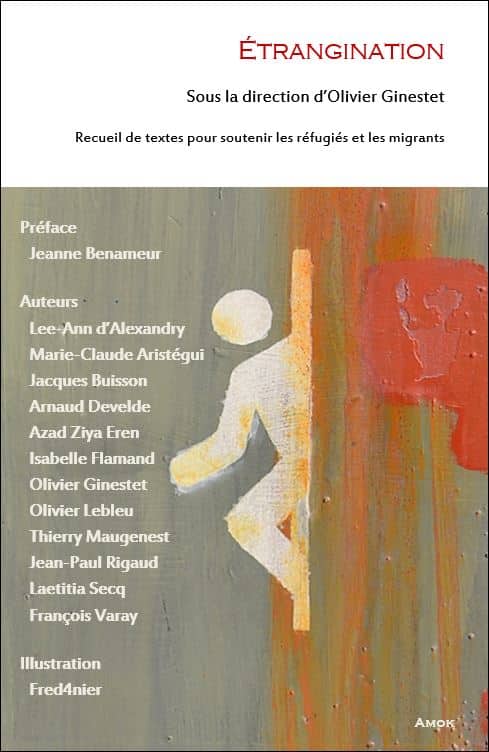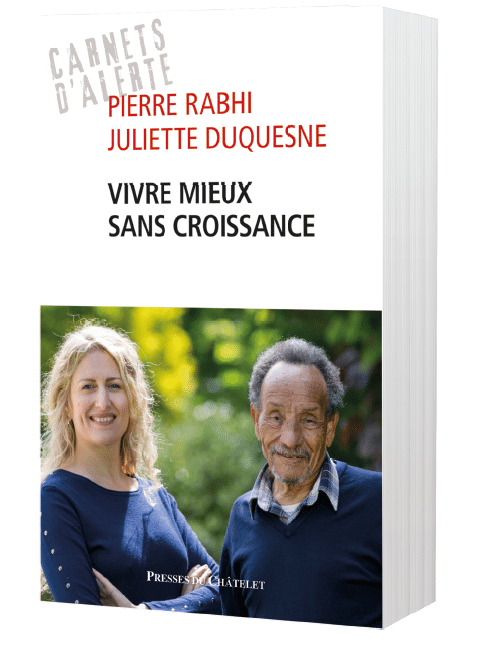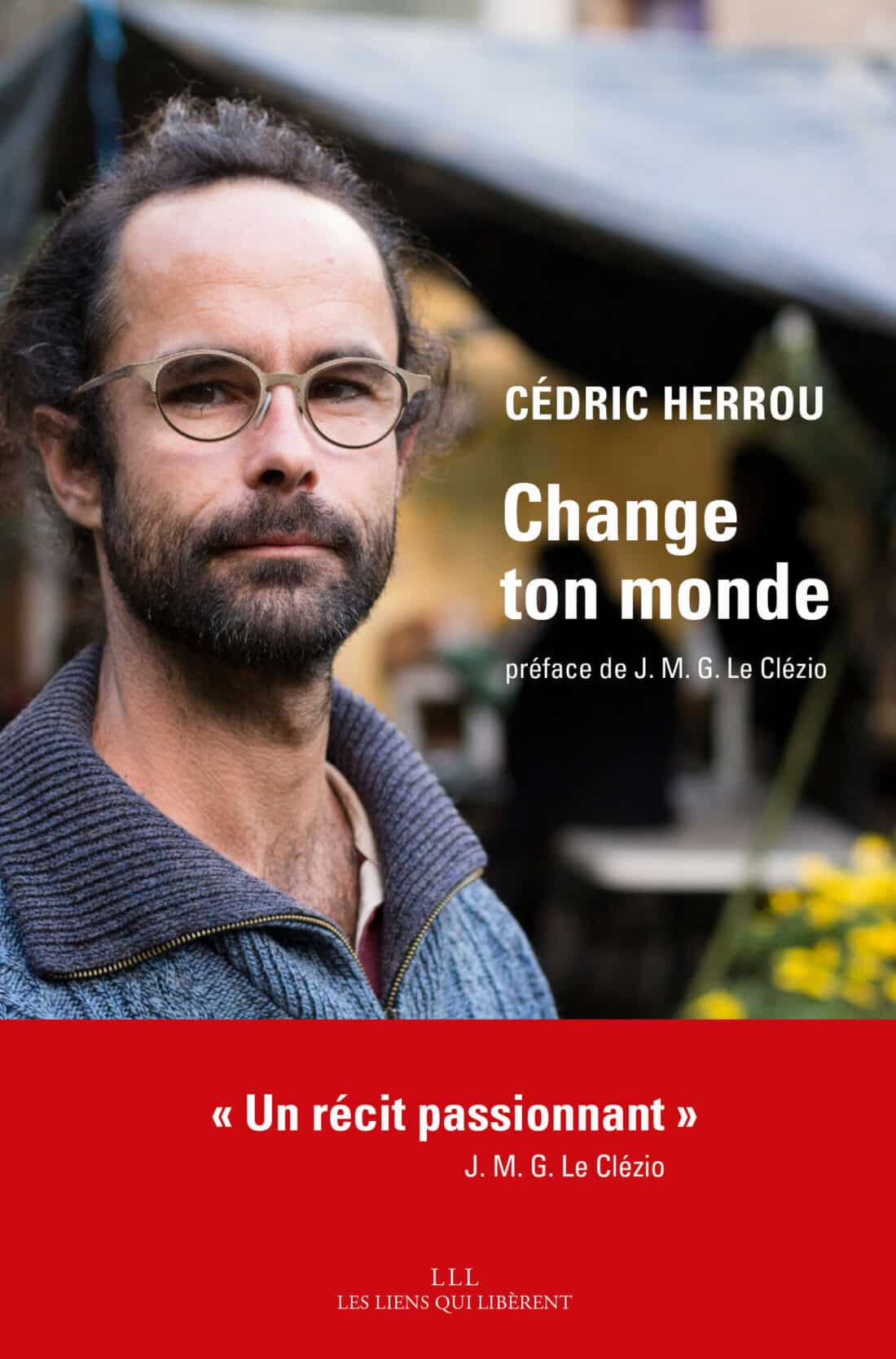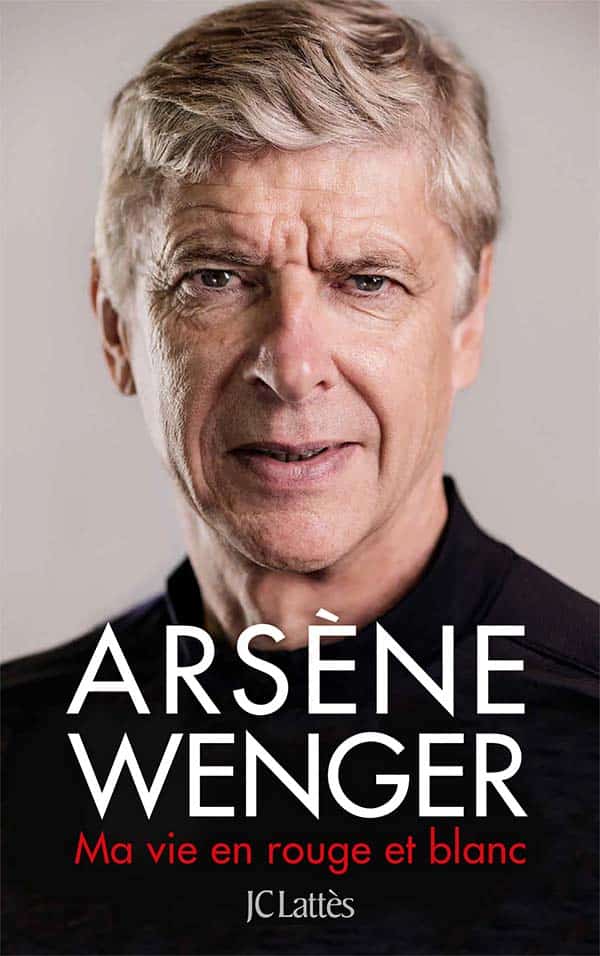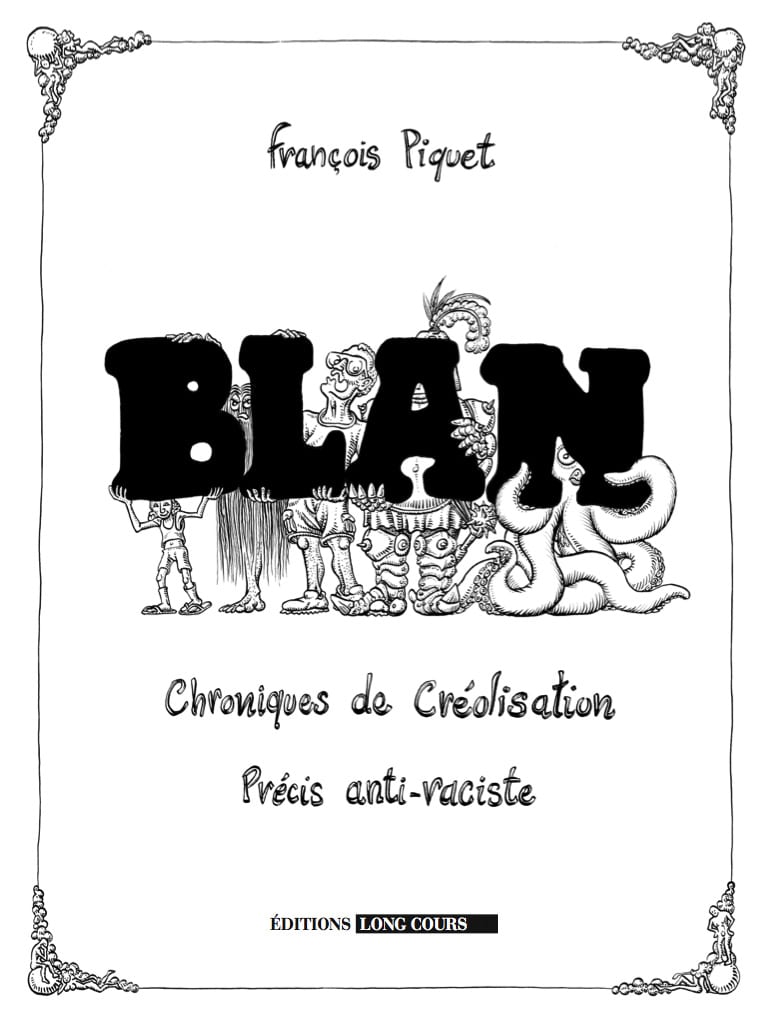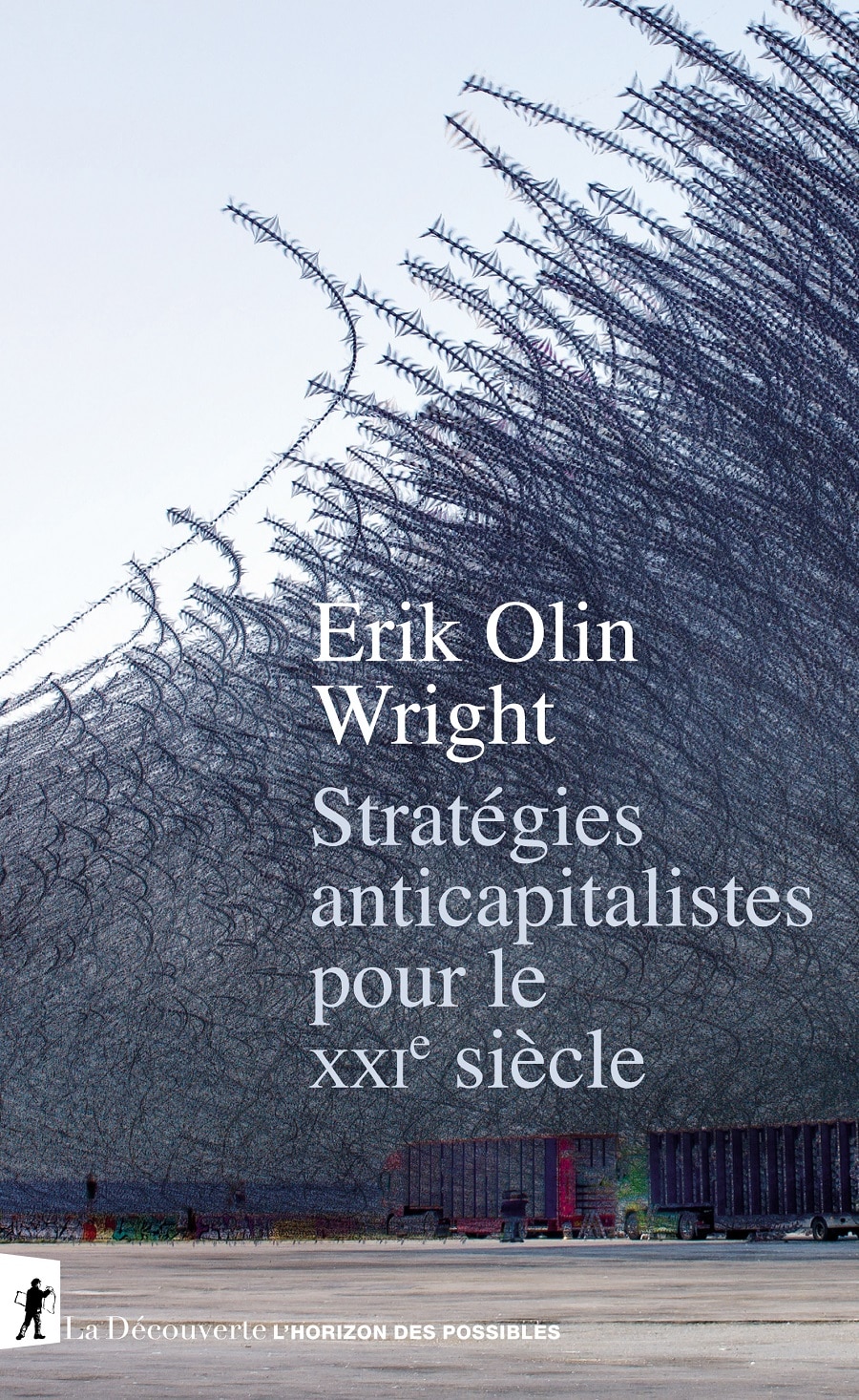Archive
Atlas historique de la France
Le meilleur de la recherche historique et de la cartographie
Forts du succès de l’Atlas historique mondial, Les Arènes et L’Histoire poursuivent leur collaboration et conçoivent l’atlas d’histoire de la France le plus complet et le plus riche. Respectant la chronologie, chaque carte est mise en situation dans une histoire globale. Aucun moment important n’a été négligé, les cartes ont été conçues à partir d’un plan qui couvre toute l’histoire de la France.
Ce récit cartographique est précédé d’une réflexion sur le rapport au roman national et suivi d’un état des lieux de l’usage que les Français font de leur passé – le tout en cartes.
Afin de réaliser un aussi grand nombre de cartes, les auteurs se sont appuyés sur le fonds cartographique de la revue L’Histoire et ont fait appel à de nombreux grands historiens (Jean-Paul Demoule, Quentin Deluermoz, Maurice Sartre, Claire Sotinel, Annette Wieviorka…). Il a fallu pas moins de sept cartographes pour venir à bout de cette œuvre.
Lire la suiteM’explique pas la vie, mec !
Les comportements masculins qui invisibilisent les femmes sont enfin mis en lumière ! Étant donné la manière dont beaucoup occupent
l’espace dans la société, des réunions professionnelles à la sphère domestique en passant par la place publique, il est temps d’éveiller les consciences.
Cet album donne aux femmes des clés pour qu’elles (re)prennent la parole et investissent leur place légitime. Sous la forme de saynètes humoristiques, sont abordés les concepts de mansplaining, de manterrupting et de manspreading, résultant d’un patriarcat bien ancré dans la société.
Il est temps pour les femmes d’imposer leur présence, d’exprimer leurs points de vue, et de faire valoir leurs
compétences. Bref, de refuser les manifestations du sexisme ordinaire et de montrer à tou.te.s qui est la boss !
Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, de Erik Olin Wright
Postface de Laurent JEANPIERRE
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe JAQUET et Rémy TOULOUSE
Mise en vente :
15/10/2020
Sciences Humaines L’horizon des possibles
180 pages – 19,00 €
Comment sortir du capitalisme ? De cette interrogation cruciale, Erik Olin Wright fait le cœur de son nouveau livre, en développant une réflexion et une argumentation puissante sur les manières d’associer ou de renforcer les différentes formes de luttes qu’il a identifiées pour dépasser le capitalisme.
Lire la suite