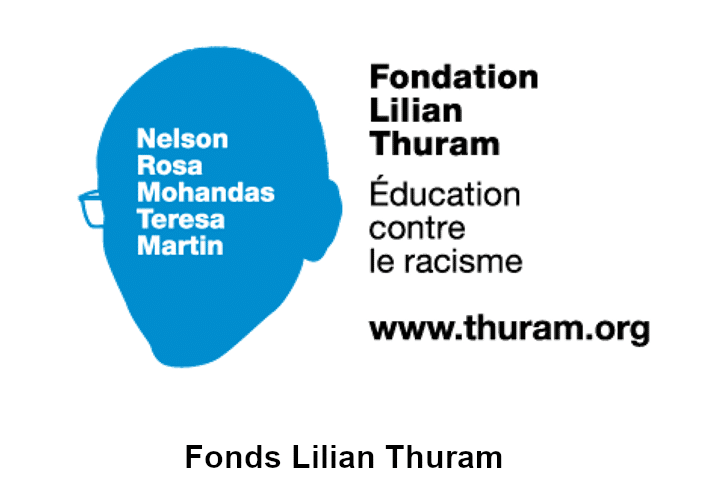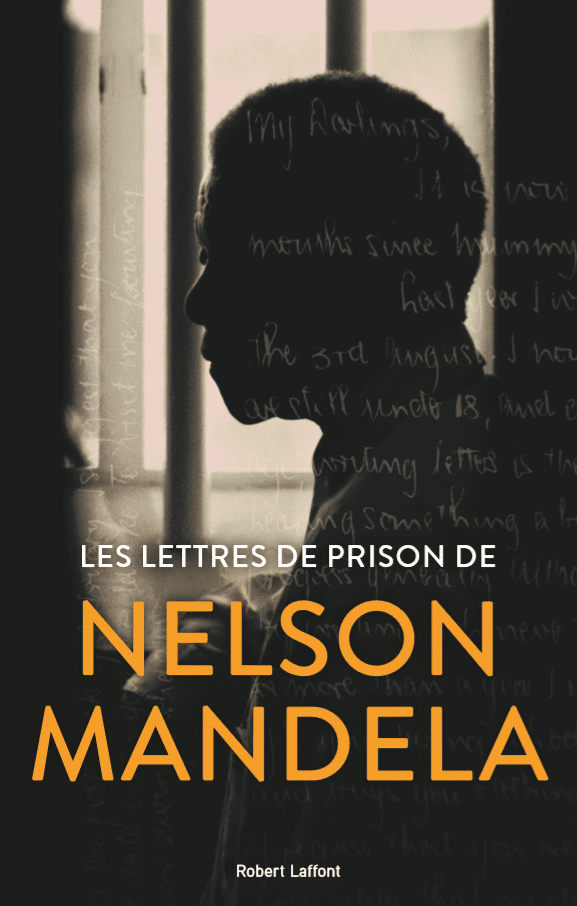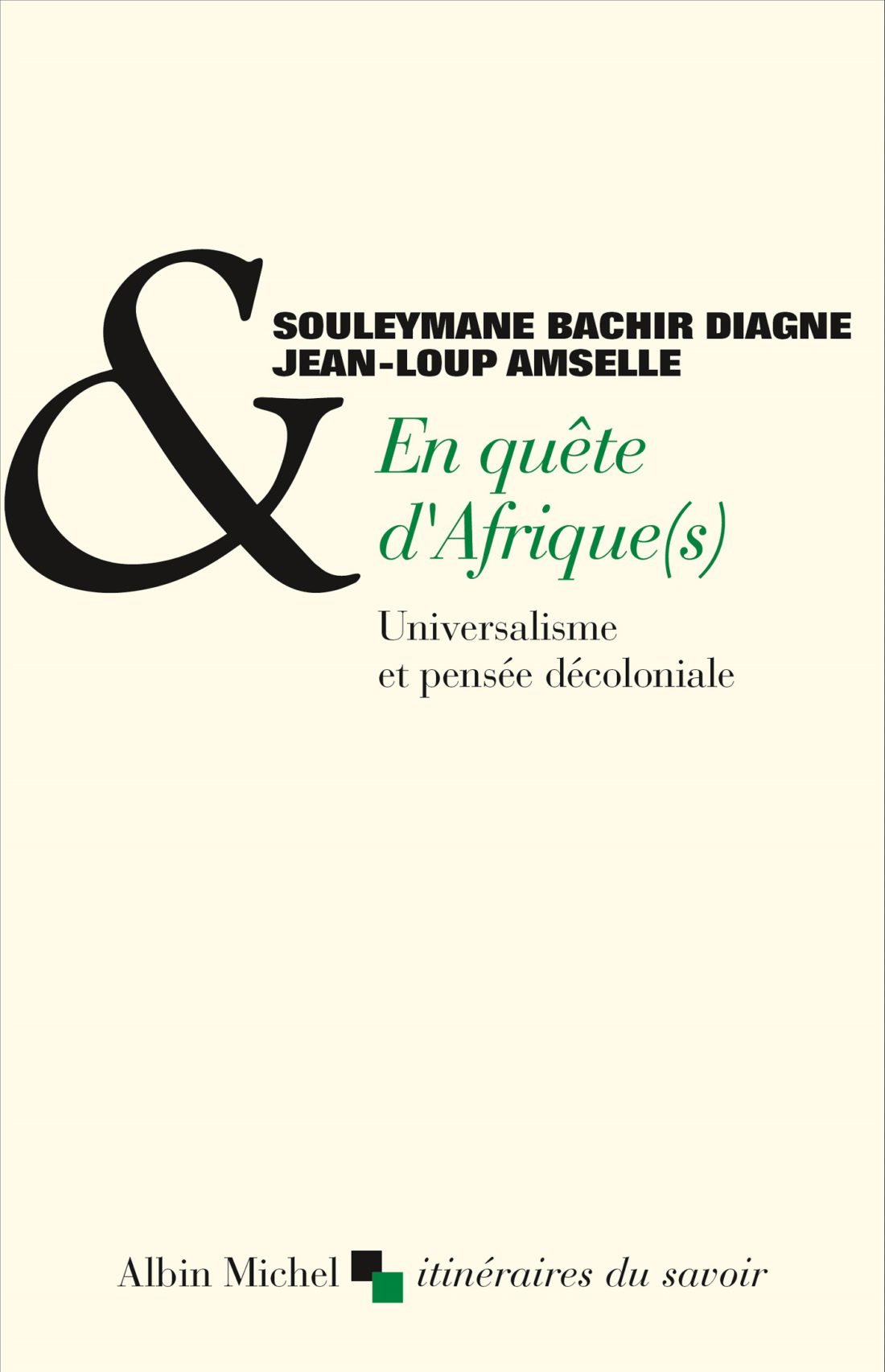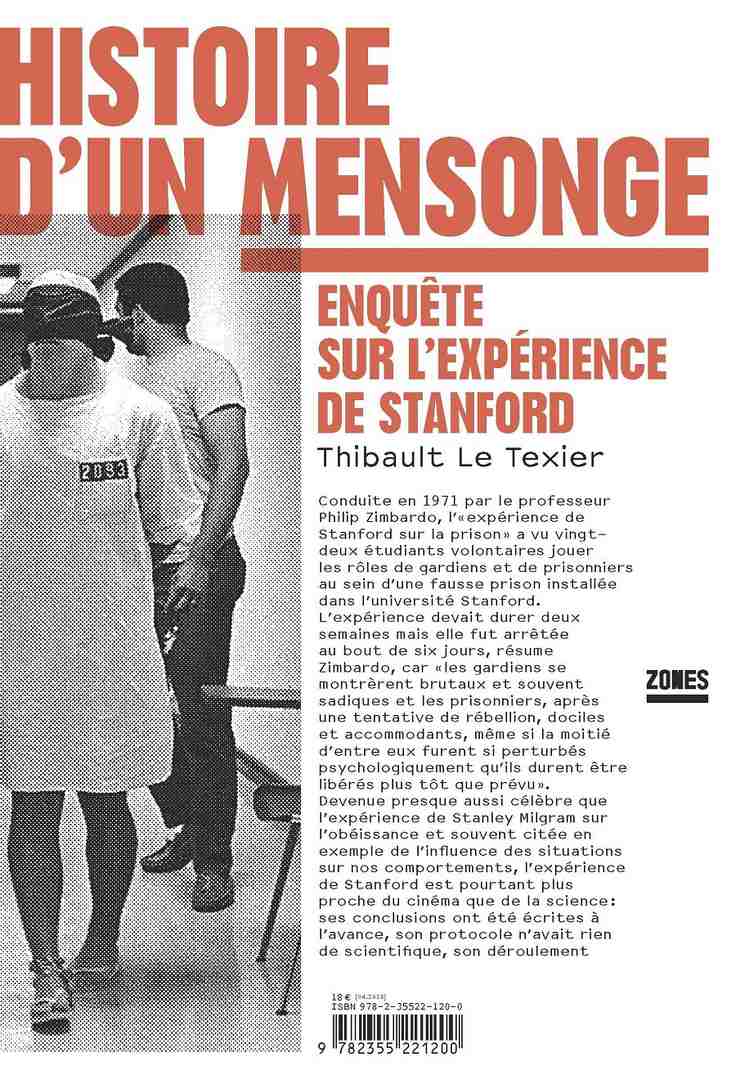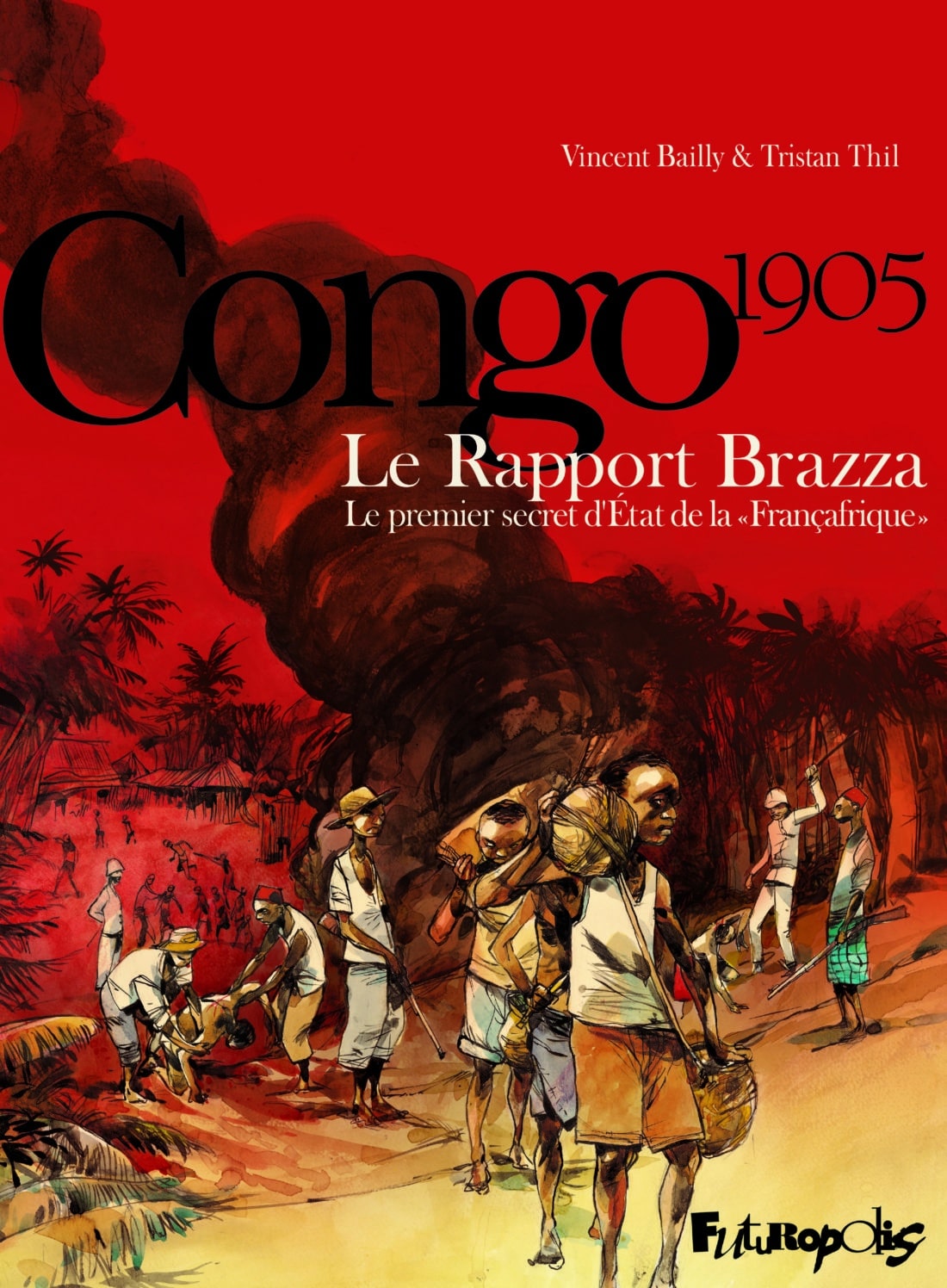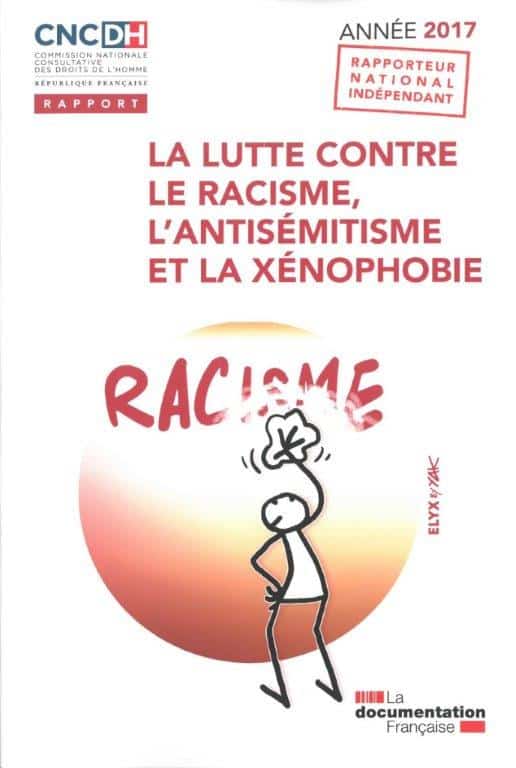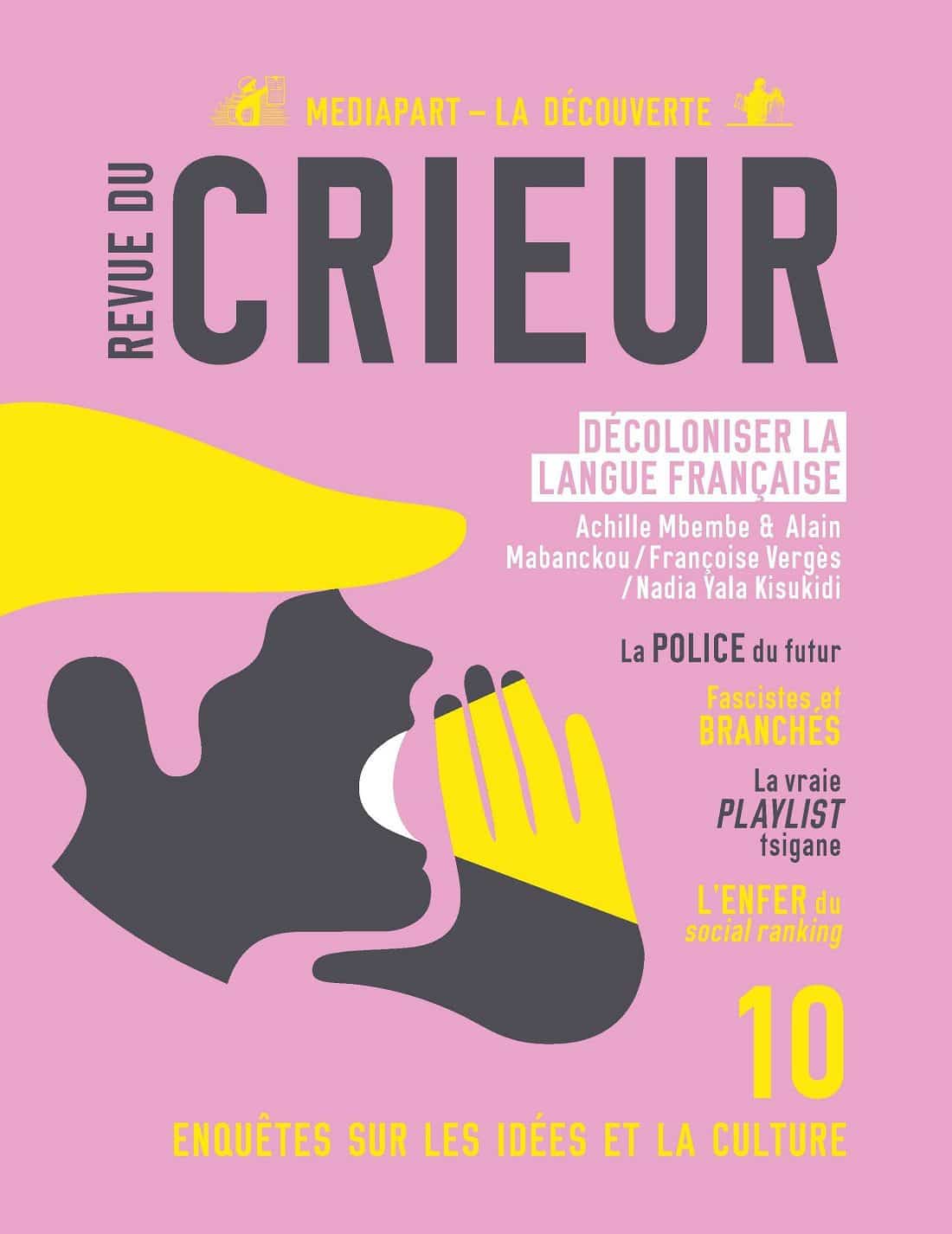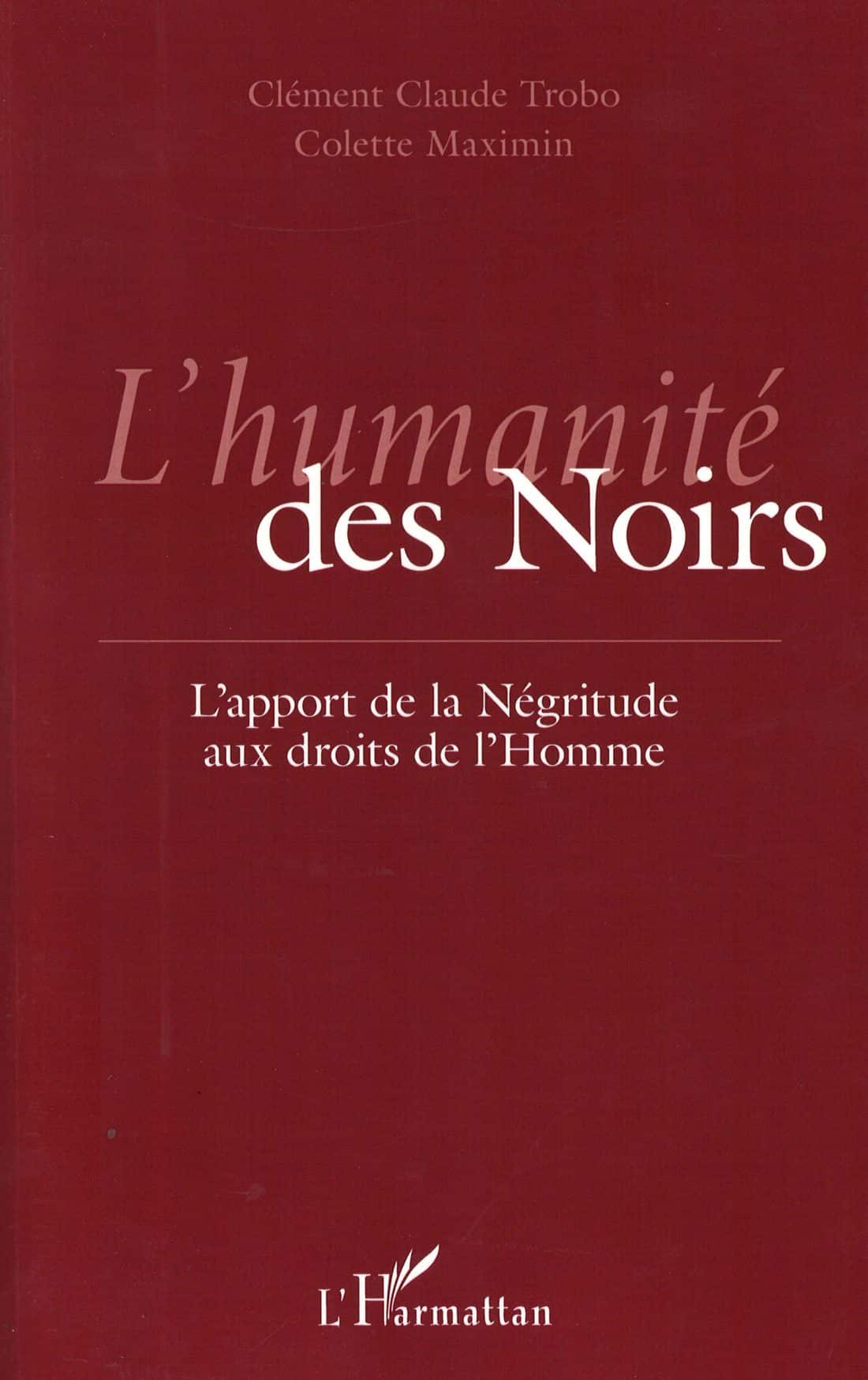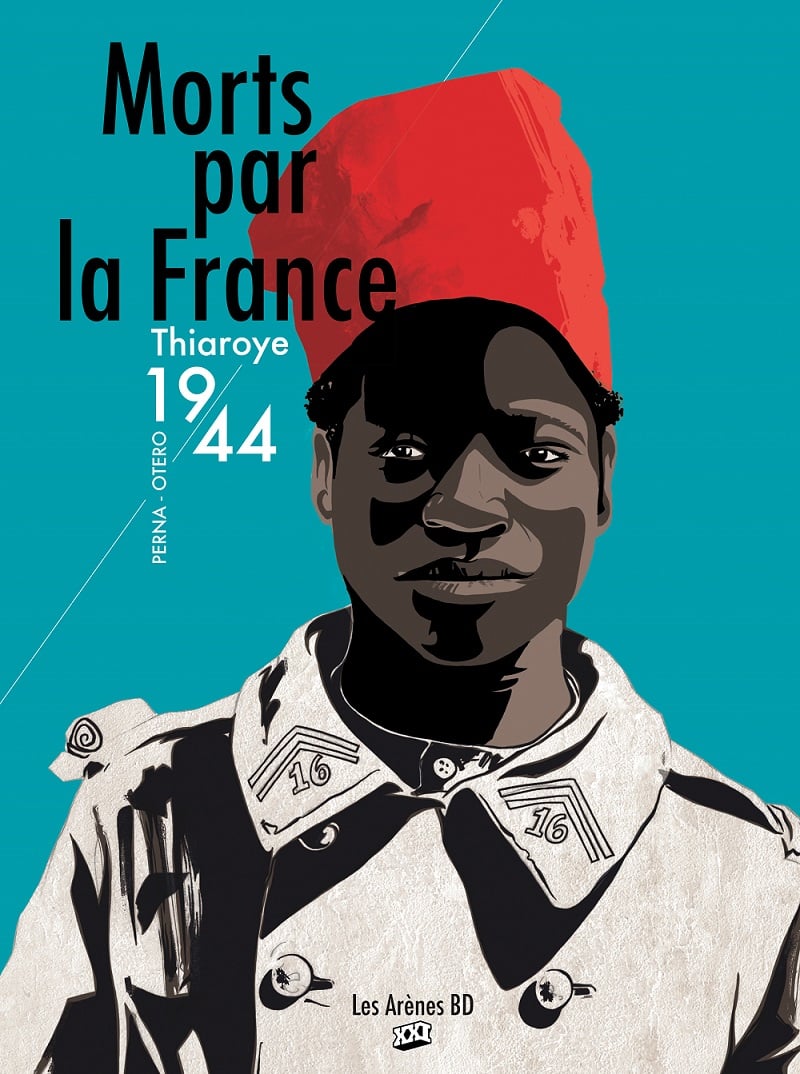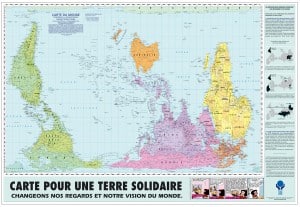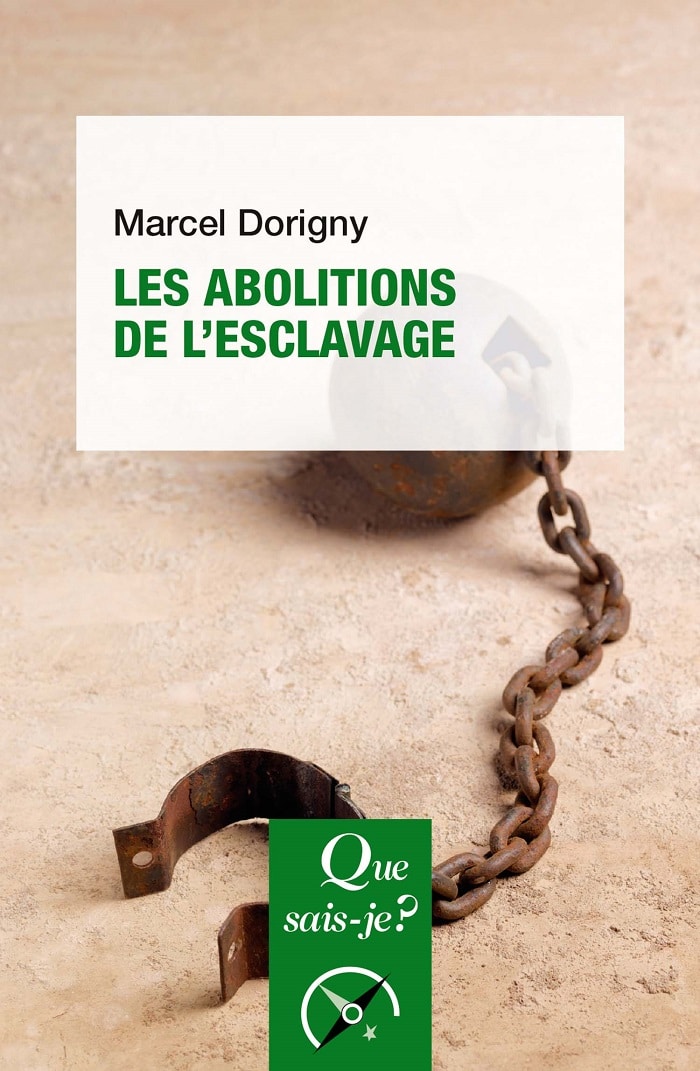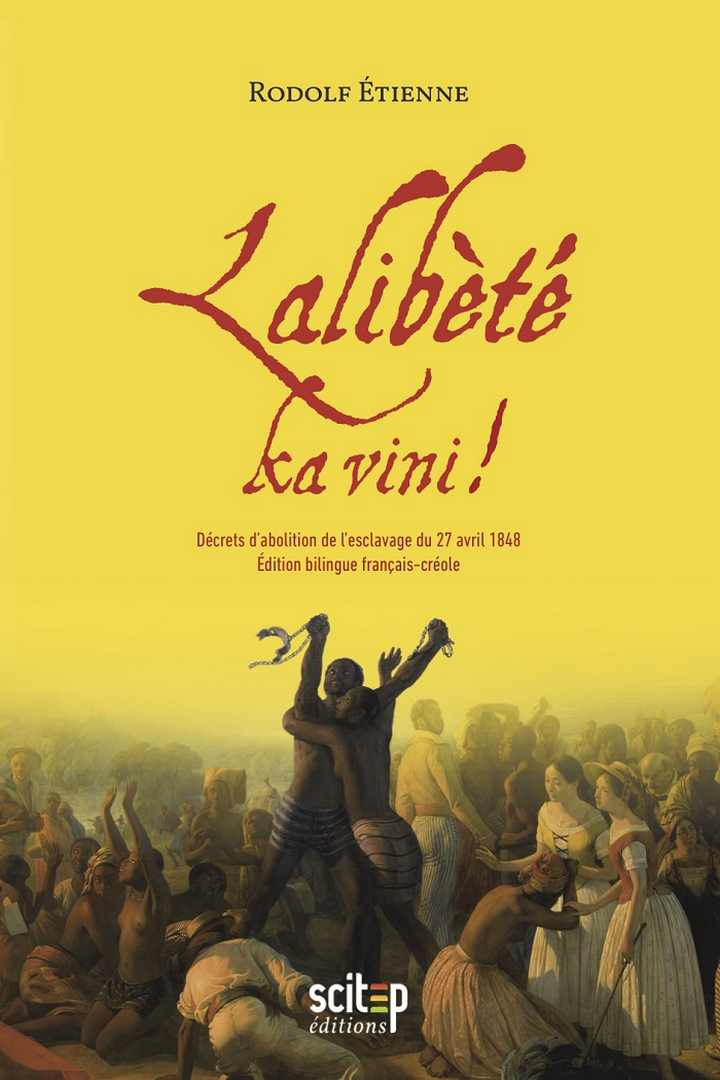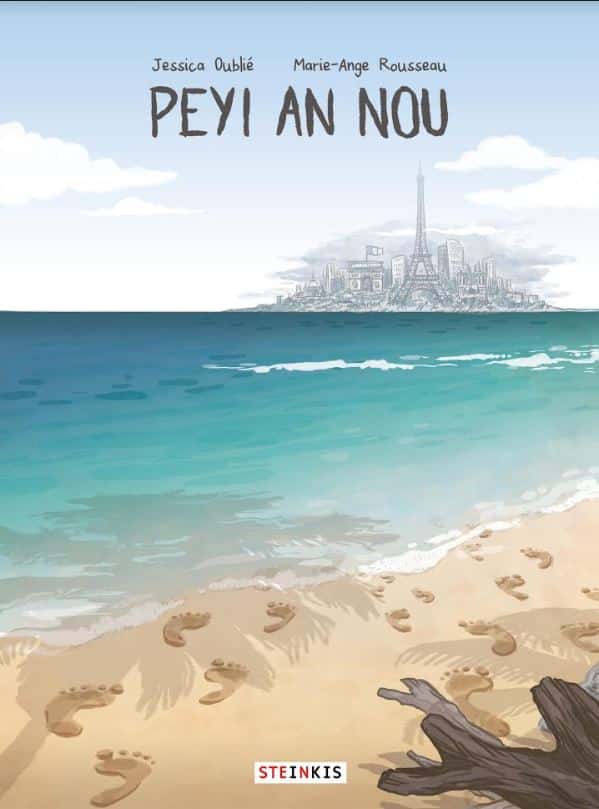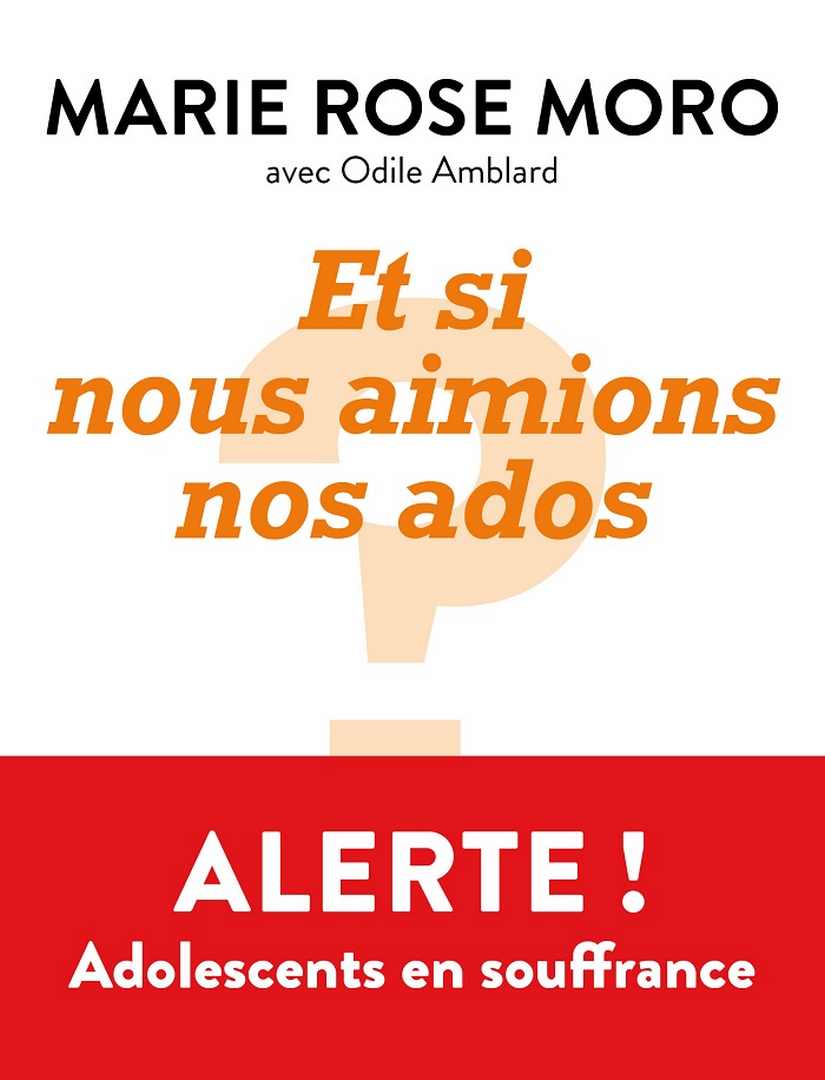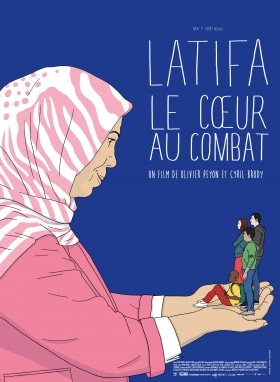Les lettres de prison de NELSON MANDELA
« Le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l’écart les bras croisés, mais par ceux qui sont dans l’arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les événements. »
Nelson Mandela
Arrêté en 1962 par le gouvernement d’apartheid d’Afrique du Sud, Nelson Mandela a passé vingt-sept ans en prison – du 7 novembre 1962 au 11 février 1990. Au cours de ces 10 052 jours de détention, il fut un épistolier prolifique, écrivant des centaines de lettres aux autorités inflexibles , à ses compagnons de lutte, aux gouvernements officiels, mais aussi à sa femme Winnie, à ses cinq enfants et, plus tard, à ses petits-enfants.
Les 255 lettres choisies dans ce livre, pour la plupart inédites, offrent le portrait le plus intime qu’on ait lu sur Nelson Mandela et un aperçu exceptionnel sur la façon dont il a vécu cet isolement. Elles révèlent l’héroïsme d’un homme qui a refusé tout compromis sur ses valeurs, l’humanité de l’une des plus grandes figures du XXe siècle.
Préface de Zamaswazi Dlamini-Mandela
Regarder l’émission de France TV Education
Lire la suite