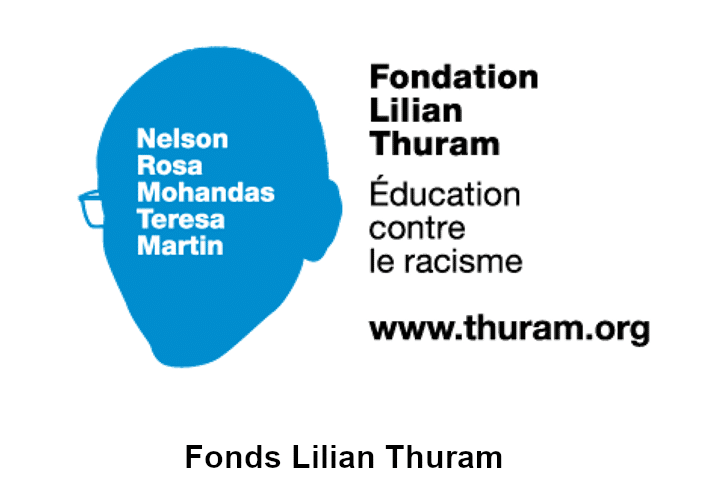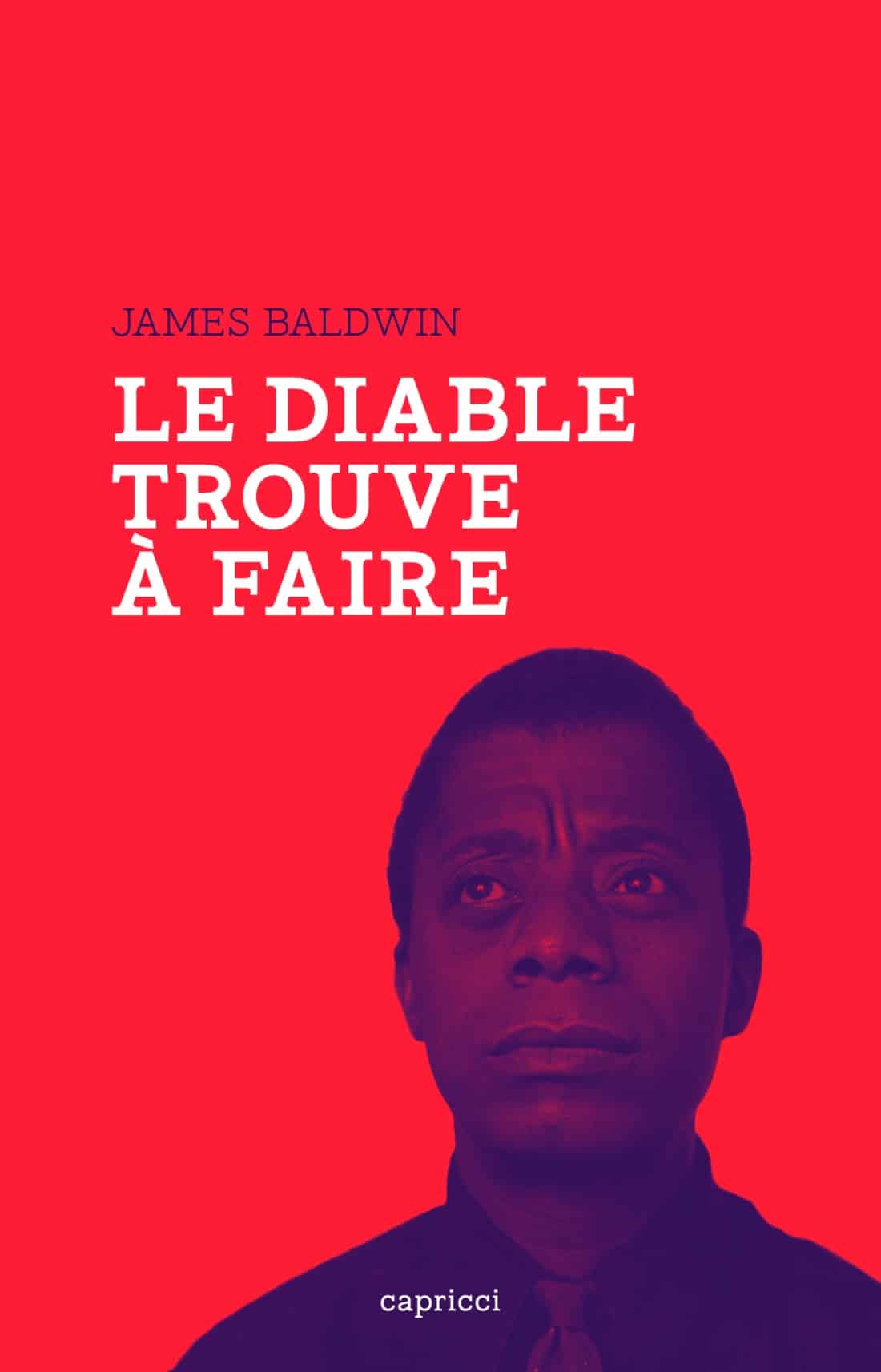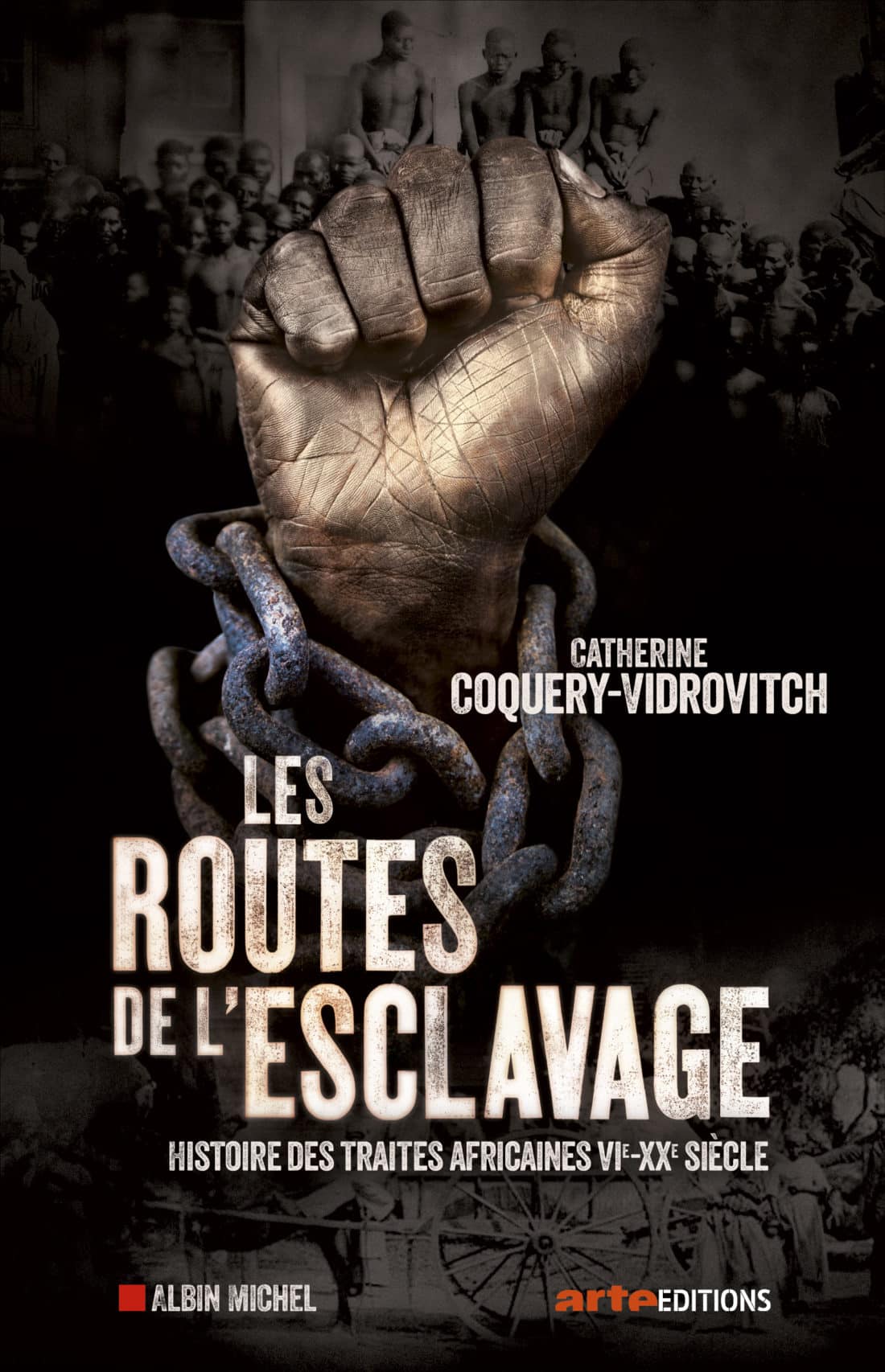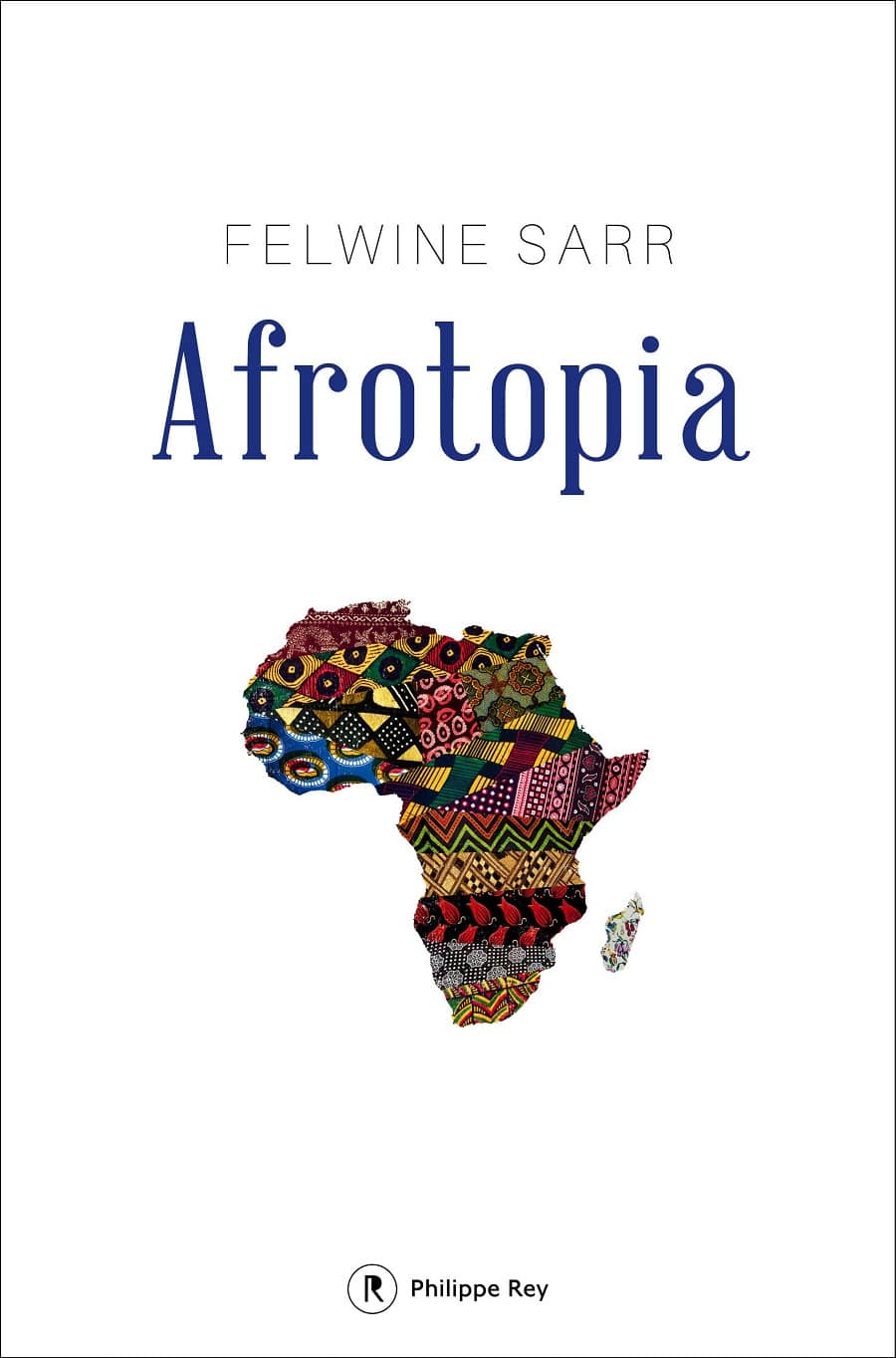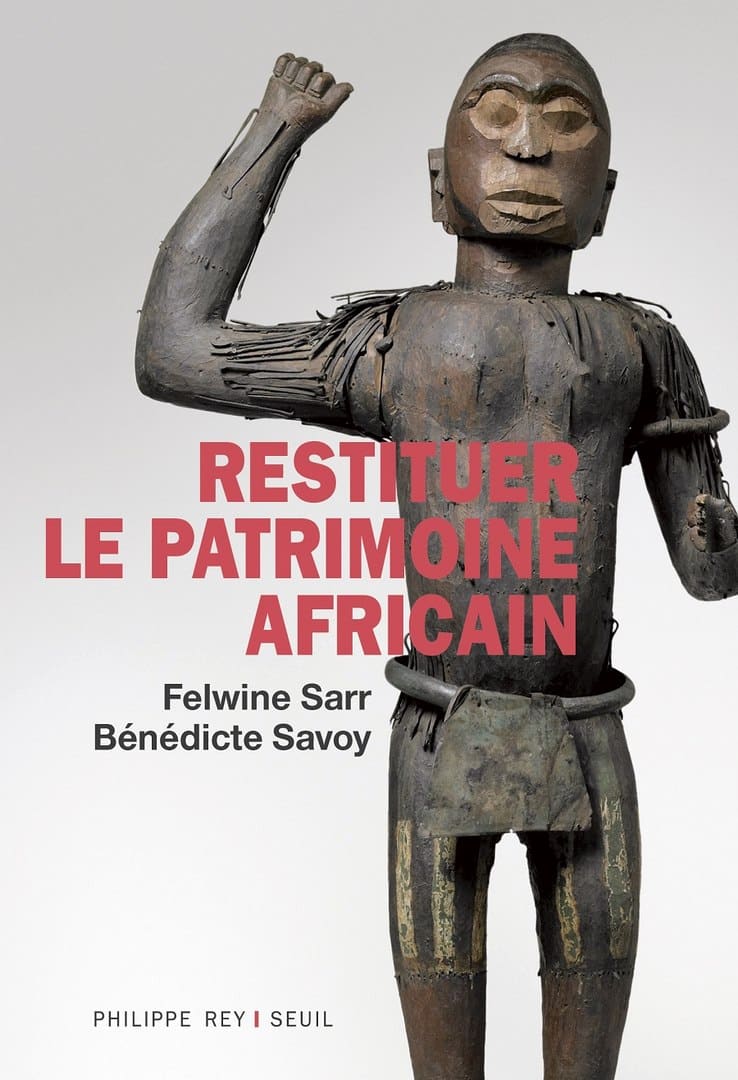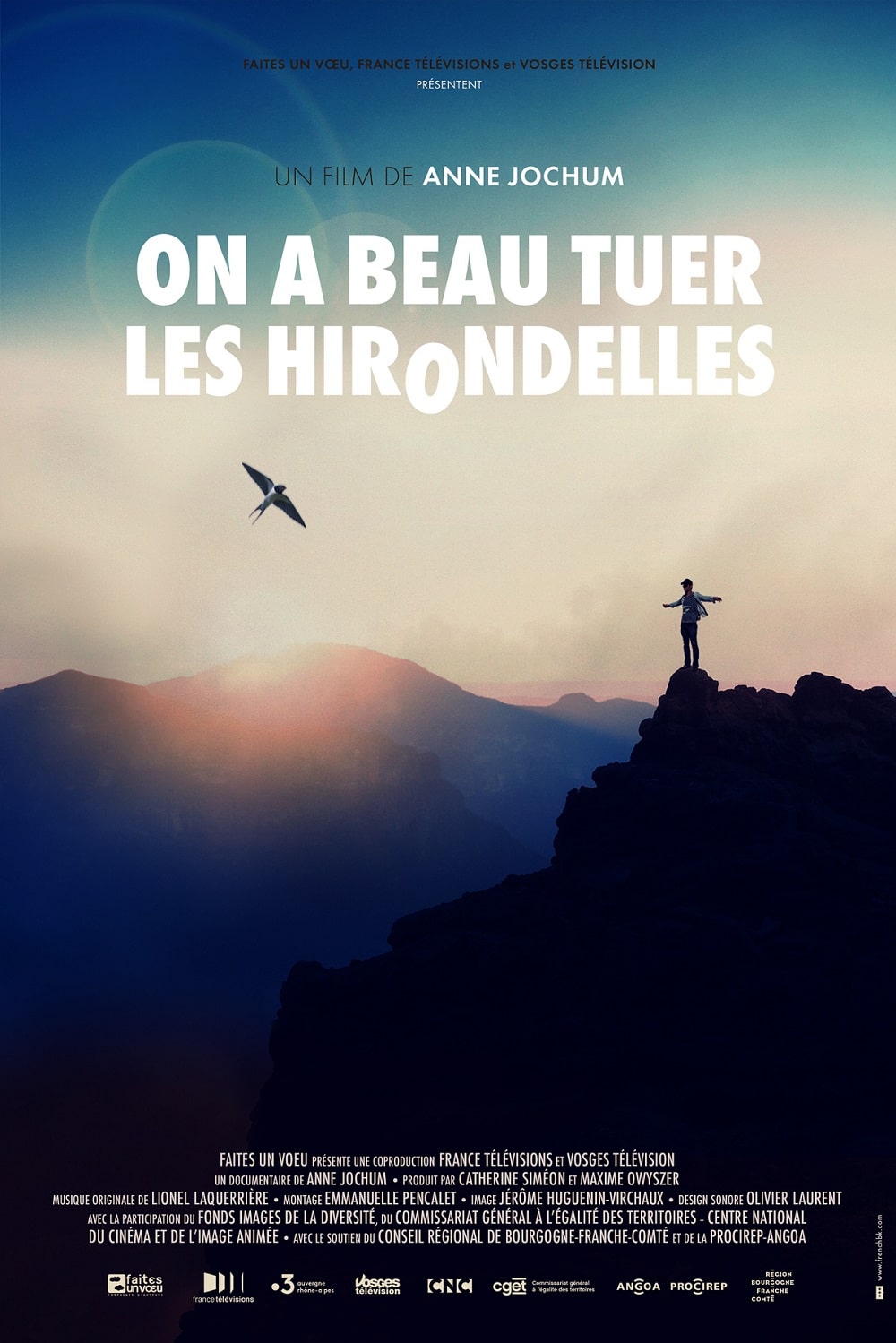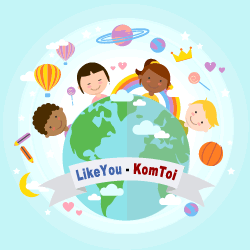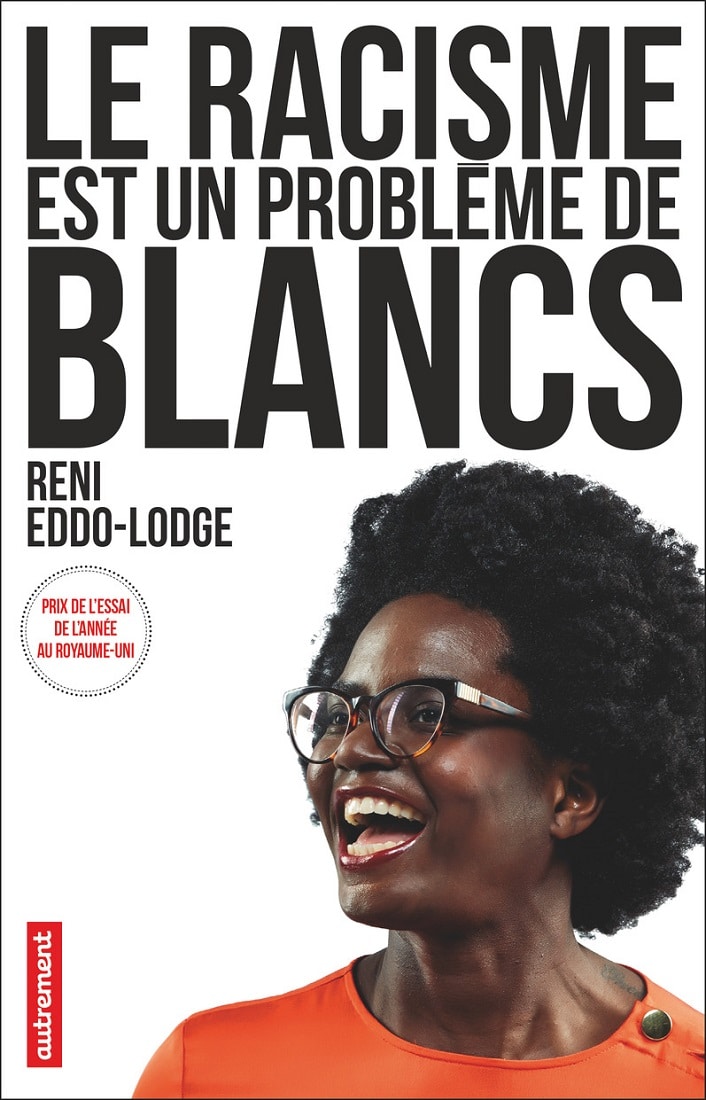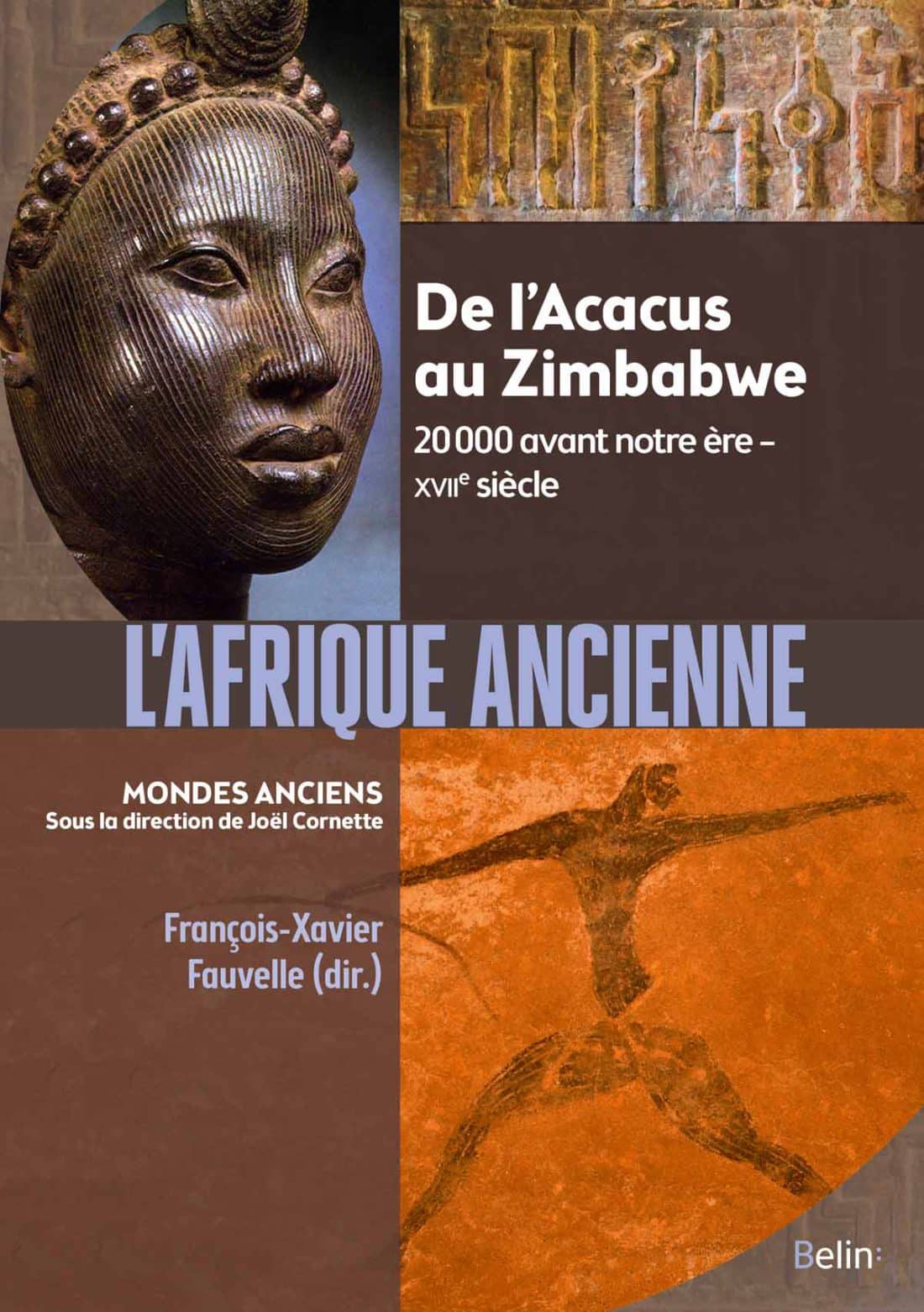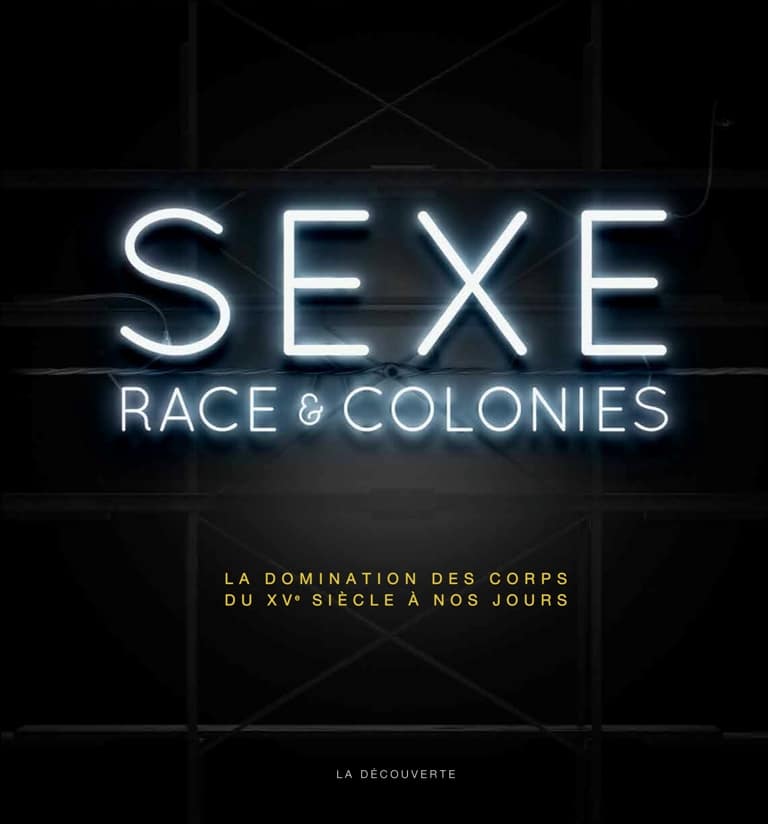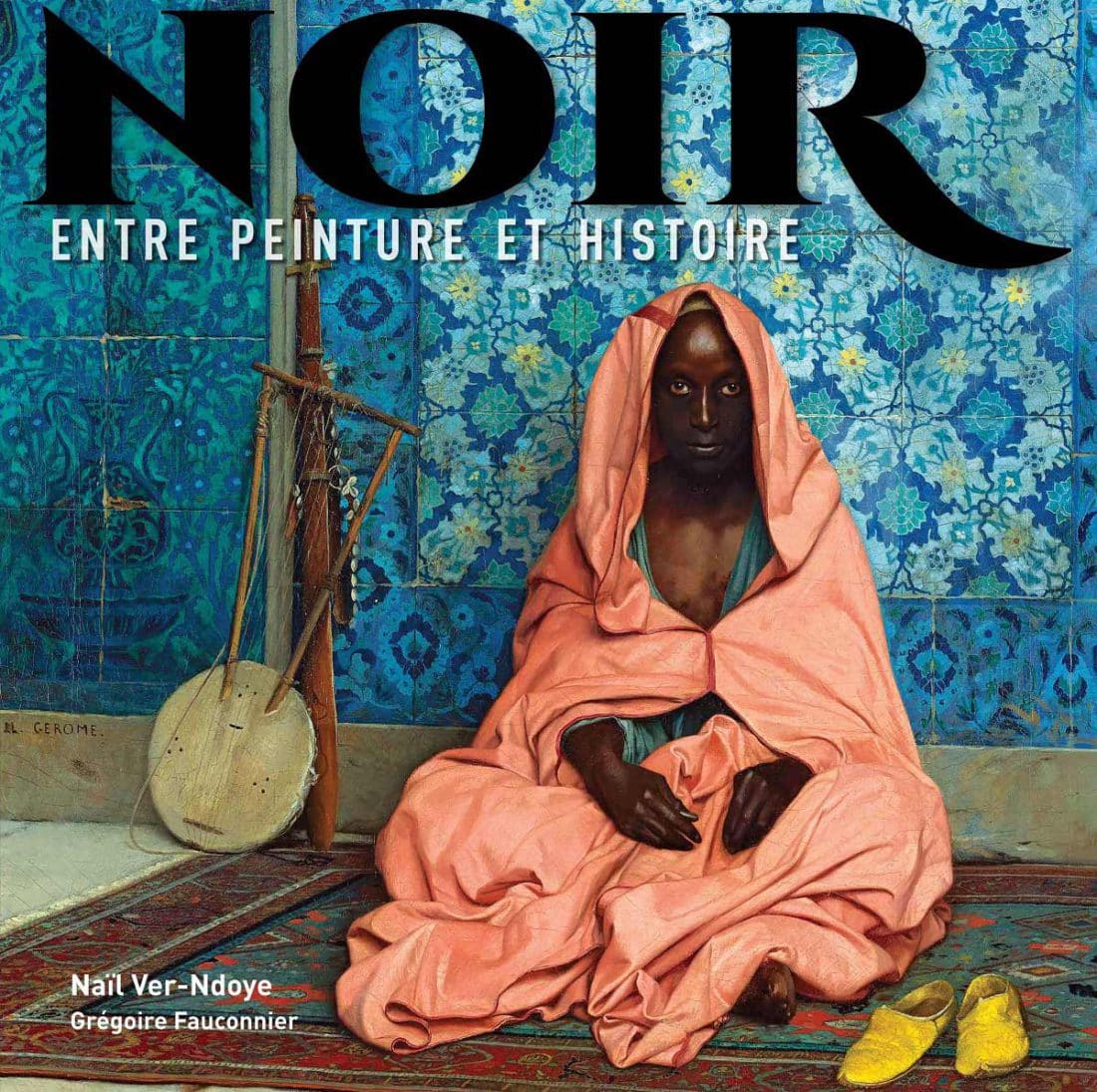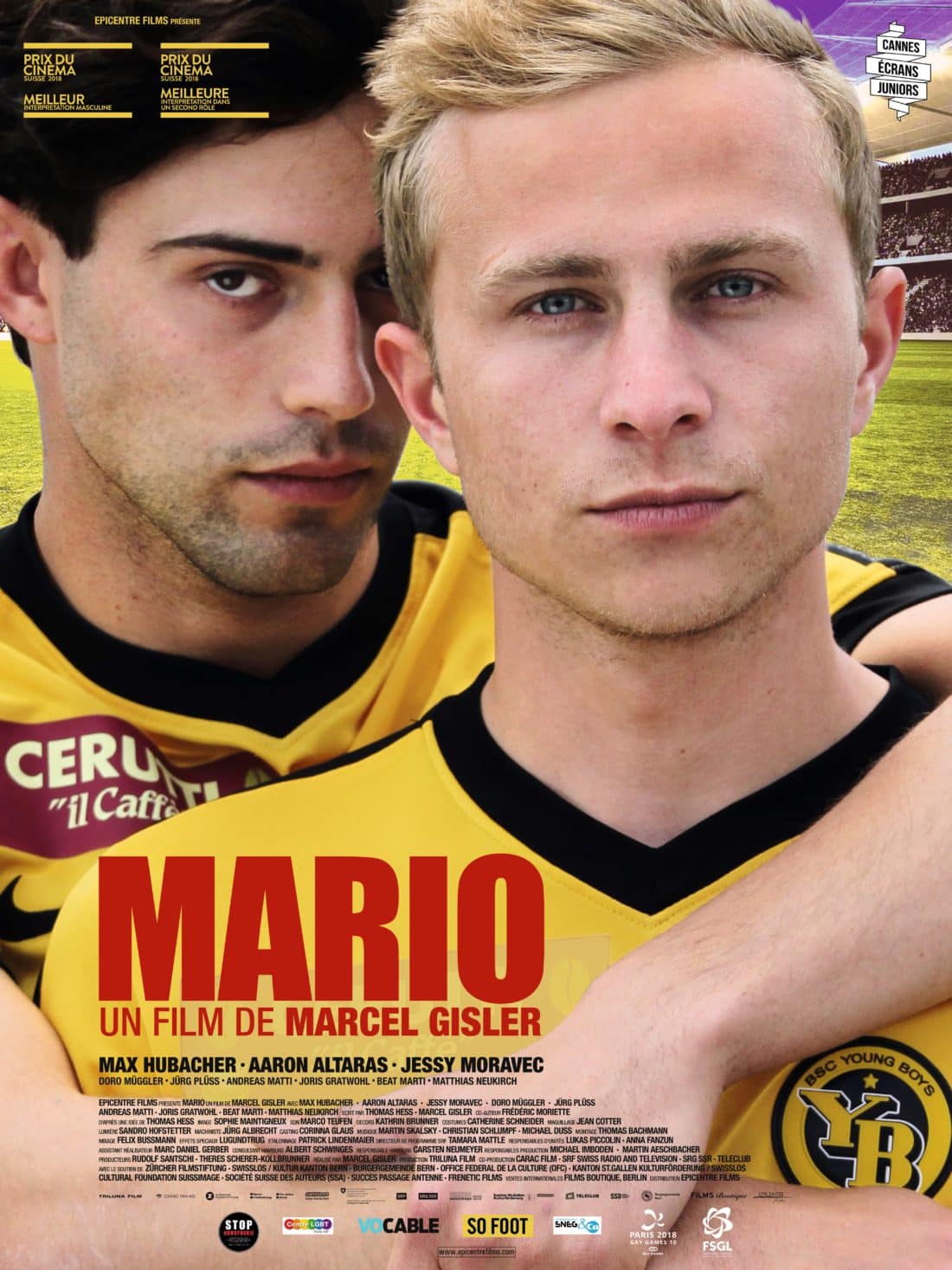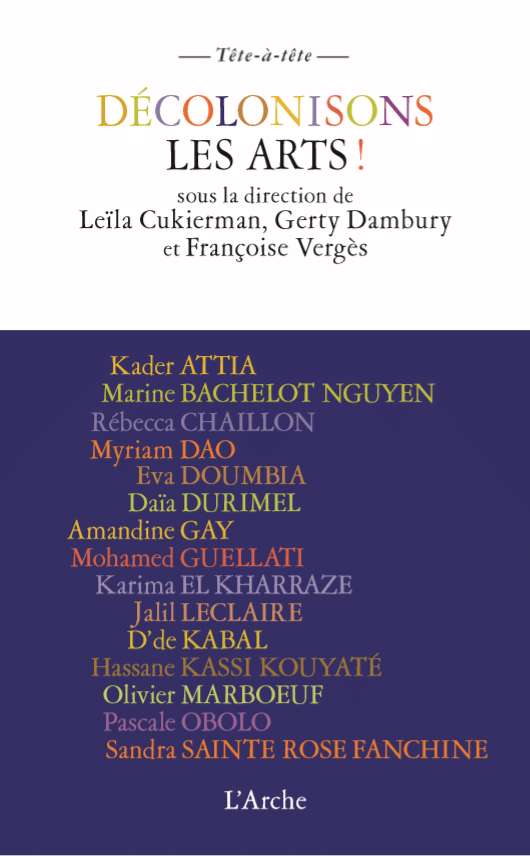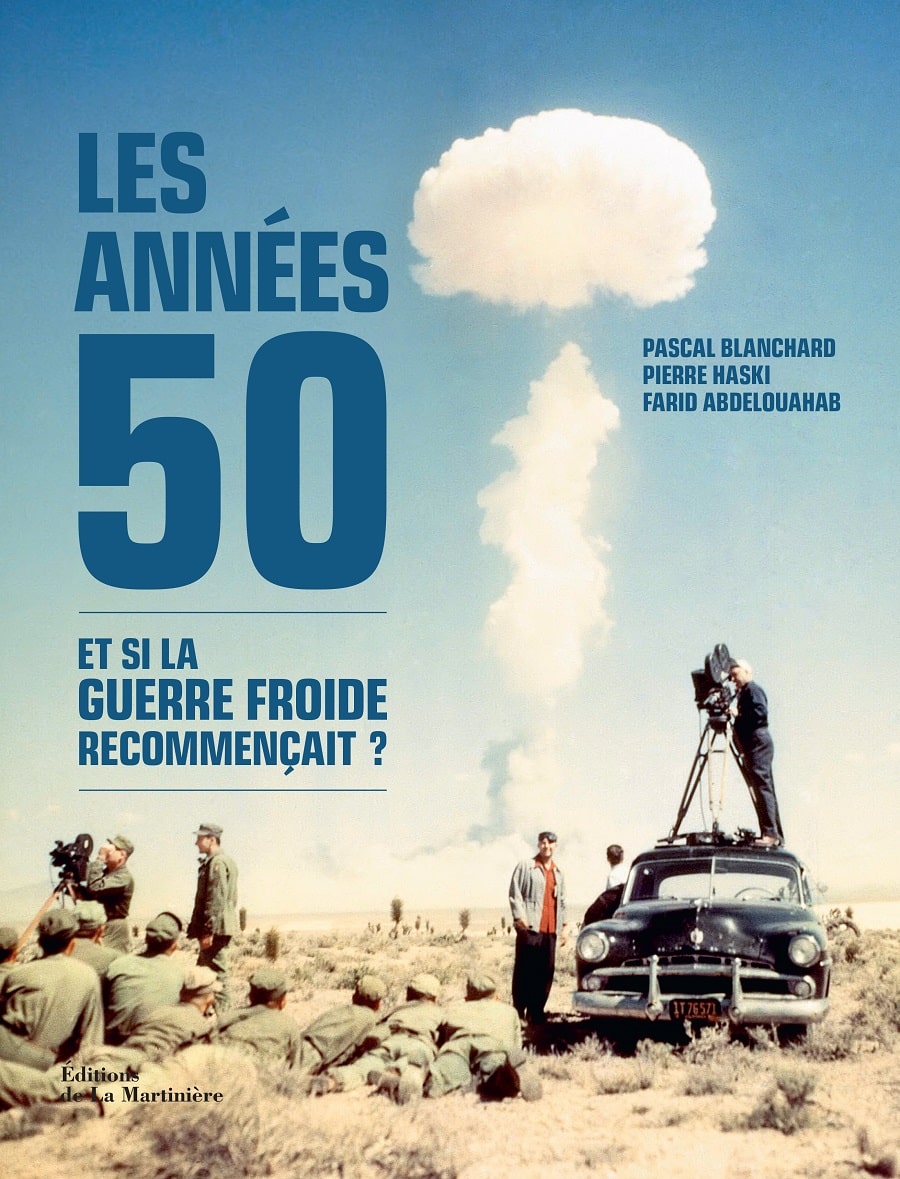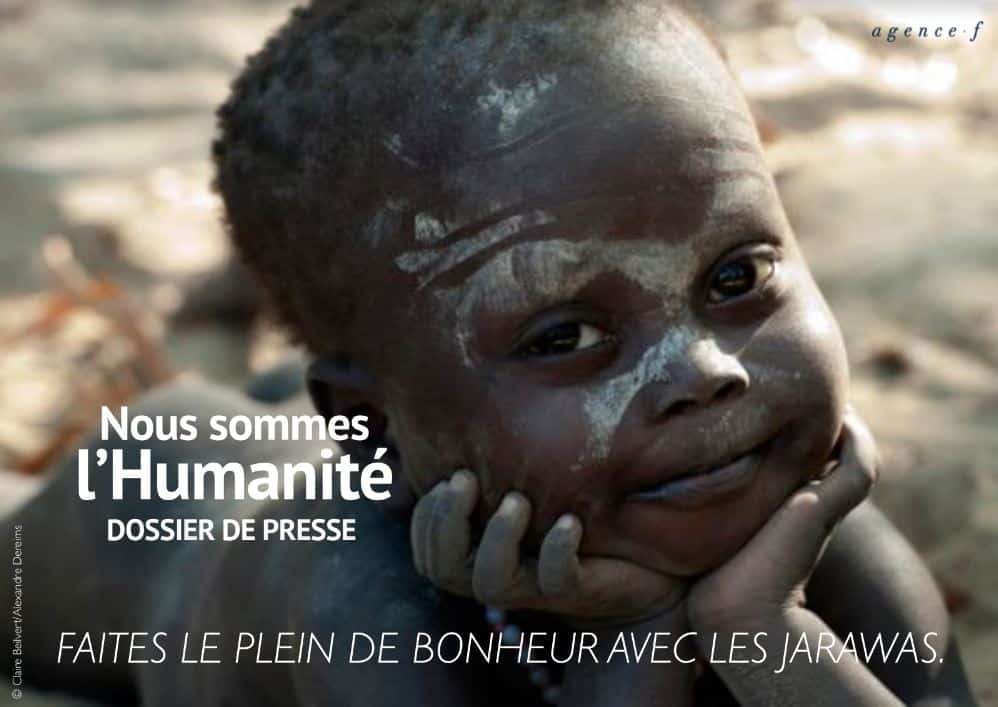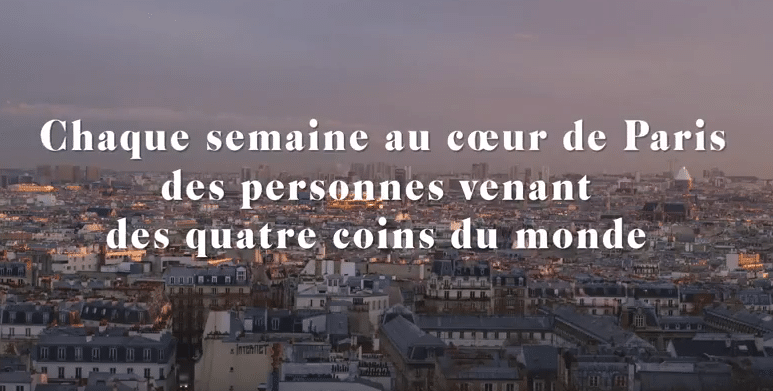Le diable trouve à faire
UN ESSAI INÉDIT DE JAMES BALDWIN SUR LE CINÉMA
Paru aux États-Unis en 1976 et jusqu’ici inédit en français, Le Diable trouve à faire révèle une autre facette du grand écrivain James Baldwin : celle d’un critique au regard incisif, attaché à explorer les fantasmes, illusions et préjugés des films qui ont marqué sa vie.
Dans son style à la fois vif et lyrique, il parcourt ses premiers souvenirs de cinéma, indissociables des difficultés familiales et de sa découverte de la société dans laquelle il vit. Naissance d’une nation, Lawrence d’Arabie, Devine qui vient dîner…, Dans la chaleur de la nuit, L’Exorciste, ou encore le physique de Bette Davis sont autant d’occasions de confronter son monde à celui d’Hollywood, et de constater le gouffre qui les sépare.
EXTRAIT
« Mon amie Ava Gardner m’a demandé un jour si je pensais qu’elle pouvait incarner Billie Holiday au cinéma. Je dus lui répondre que, même si elle avait sans doute tout ce qu’il fallait pour ça – elle était assez courageuse, honnête et belle -, il était presque certain qu’on ne le tolérerait pas, puisqu’il était de notoriété publique que Billie Holiday était noire et qu’elle, Ava Gardner, était blanche. Ce n’était pas vraiment une plaisanterie, ou alors une plaisanterie amère, car je connais assurément certaines filles noires bien plus blanches qu’Ava. »
Écrits à Saint-Paul de Vence à la fin de sa vie, ces mémoires très littéraires qui font écho au texte de I Am Not Your Negro occupent une place unique dans l’oeuvre de Baldwin. Ils sont aussi une forme de critique cinématographique inconnue de ce côté de l’Atlantique. Aux États-Unis, la vision du cinéma que propose Baldwin a été un véritable électrochoc pour la presse et de nombreux penseurs, tant il passe à l’acide les archétypes du Noir et du Blanc que Hollywood a largement contribué à banaliser.