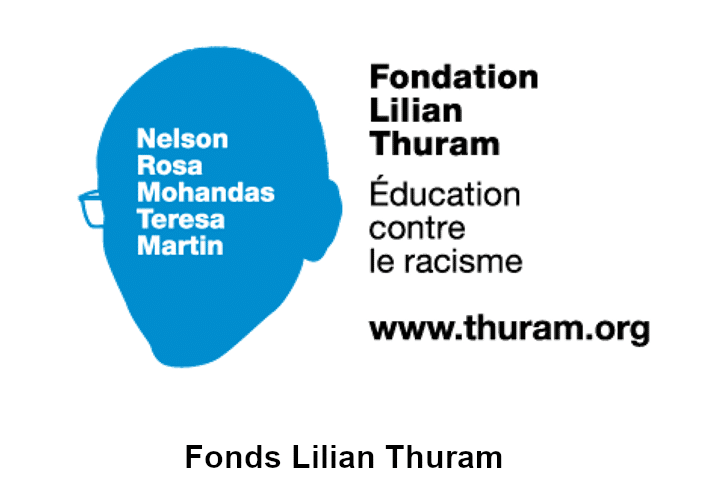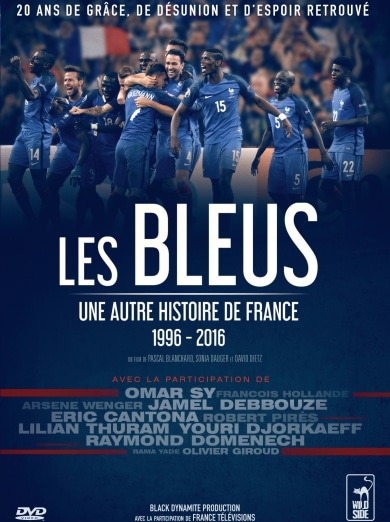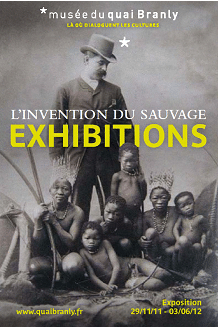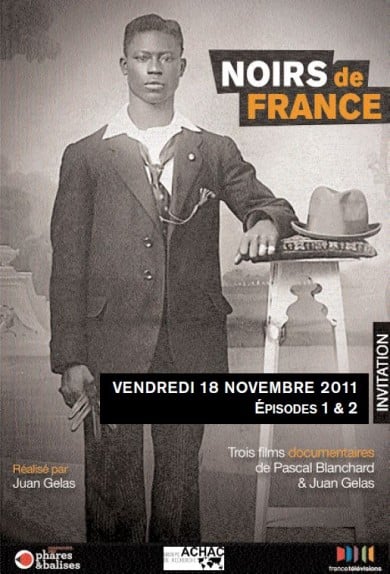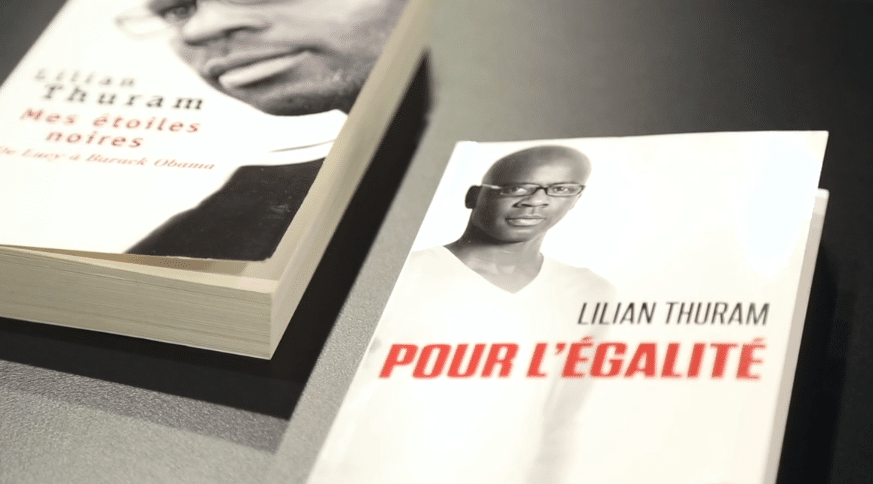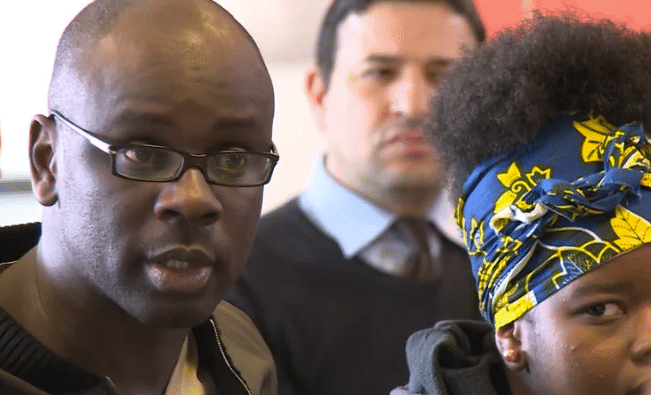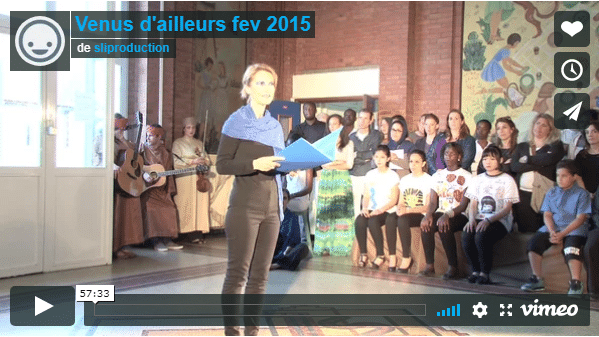Dans
Les zoos humains, symboles inavouables de l’époque coloniale et du passage du XIXe au XXe siècle, ont été totalement refoulés de notre histoire et de la mémoire collective. Ils ont pourtant existé, et c’est par dizaines de millions (400 millions selon les estimations les plus basses) que les Européens et les Américains sont venus découvrir, pour la première fois, le « sauvage »… dans des zoos, des foires, des expositions officielles, des exhibitions ethnographiques et coloniales ou sur la scène des cabarets. Revenir sur cette page essentielle, tel est l’enjeu de ce film Zoos Humains.
À partir de documents d’archives, films et photographiques inédits, datés des toutes premières années du cinéma à partir de 1896, c’est une sorte de voyage sur les traces encore présentes de ces zoos humains : du zoo Hagenbeck de Hambourg au musée de Tervuren à Bruxelles, du stade de Wembley à Londres au Jardin d’Acclimatation de Paris, du Jardin tropical de Nogent à l’esplanade du Quai Branly (futur musée des arts premiers) où furent exhibés quatre cents spécimens africains en 1896. Autant de traces qui prouvent l’énorme impact de ces exhibitions en Occident, et comment le Sauvage est devenu une réalité pour des millions de visiteurs.
Ce film, issu de trois ans de recherches internationales et pluridisciplinaires, est aussi le fruit d’un travail scientifique et de documentation important. Commencé avec les équipes de du Groupe de recherche Achac et du GDR CNRS 2322 en janvier 1999, synthétisé lors du colloque international de Marseille en juin 2001 avec les 50 meilleurs spécialistes internationaux, diffusé lors du cycle de conférences d’octobre à décembre 2001 à l’Institut du Monde Arabe et regroupé dans le livre Zoos humains. De la vénus Hottentote aux réalités shows en 2002*, il vient clôturer un cycle qui se situe clairement entre sciences et diffusion du savoir.
Avec la participation et les interventions de spécialistes internationaux anglais, allemands, américains, belges, français, dont André Langanay, Sylvie Chalaye, Gilles Boetsch, Hilke Thode-Arora, Nicolas Bancel, Robert Rydell, John MacKenzie, Gérard Lévy, Claus Hagenbeck, Boris Wastiau, et Jean-Pierre Jacquemin.
Lire la suite